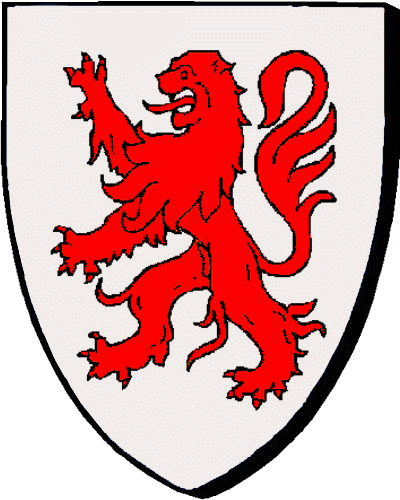
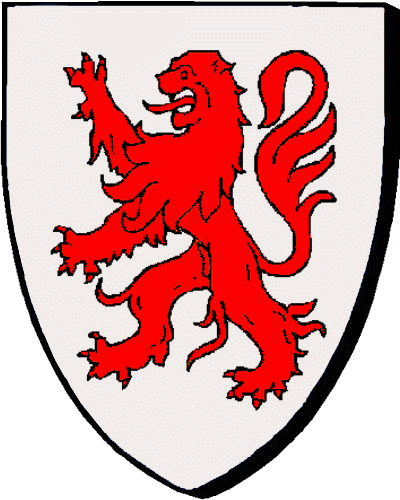
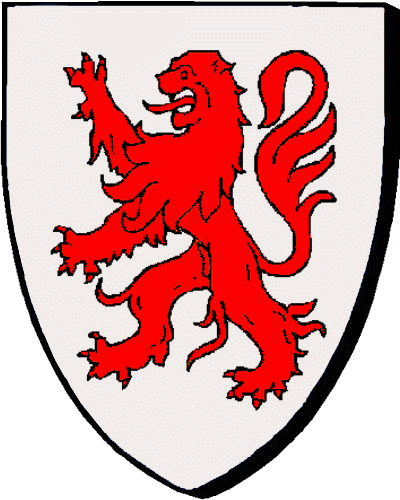
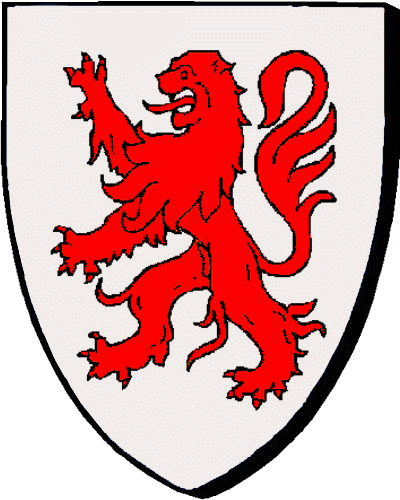
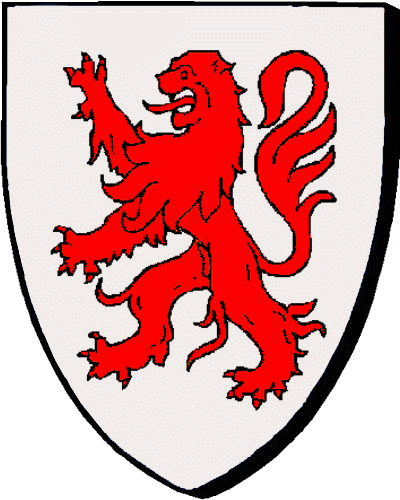
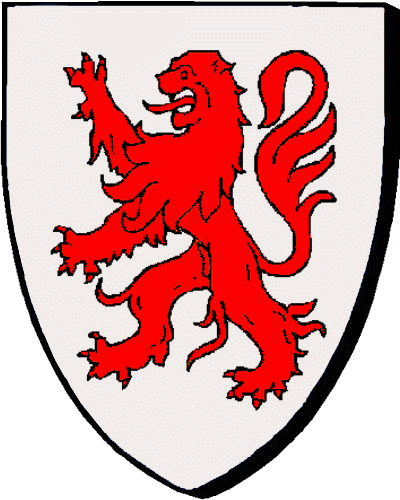
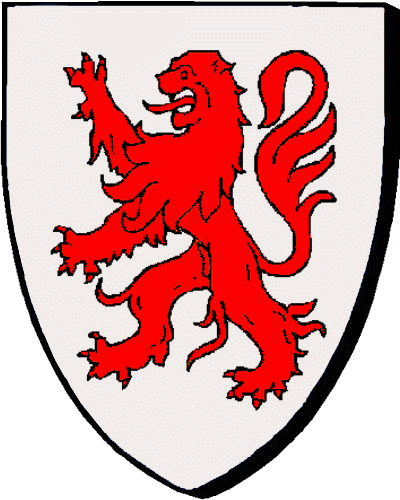
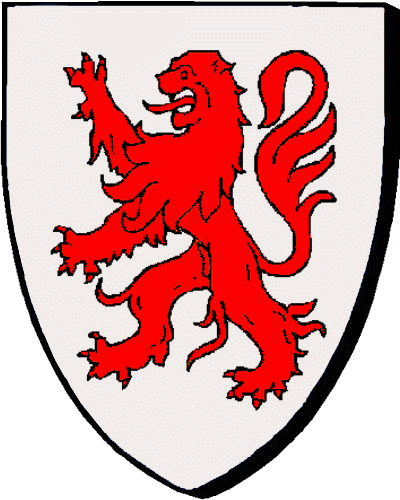
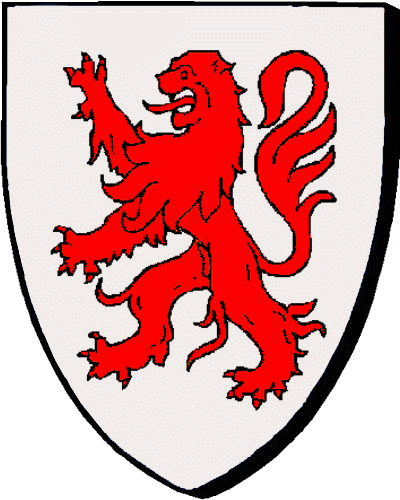
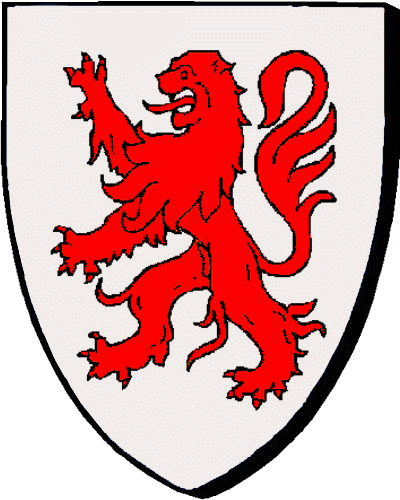
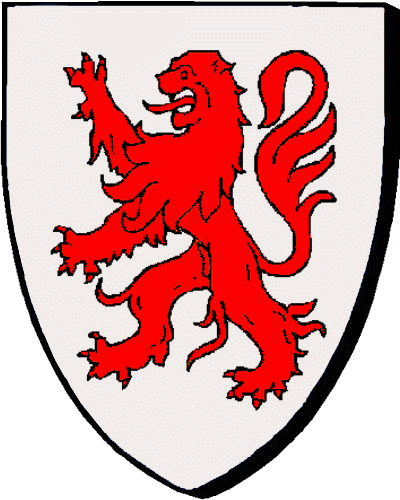
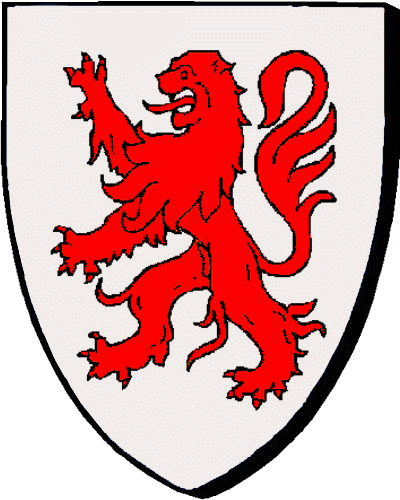
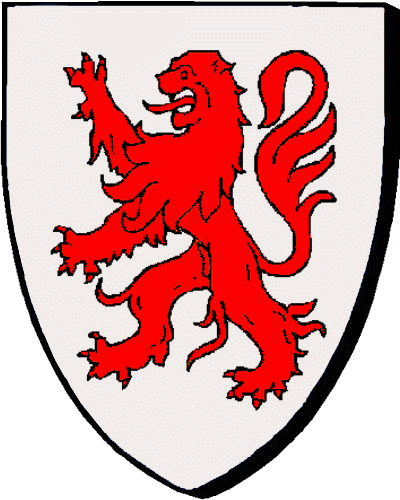
| retour à la page Histoire | en dro d'ar bajenn an istor | back to the home page history |
|
![]()
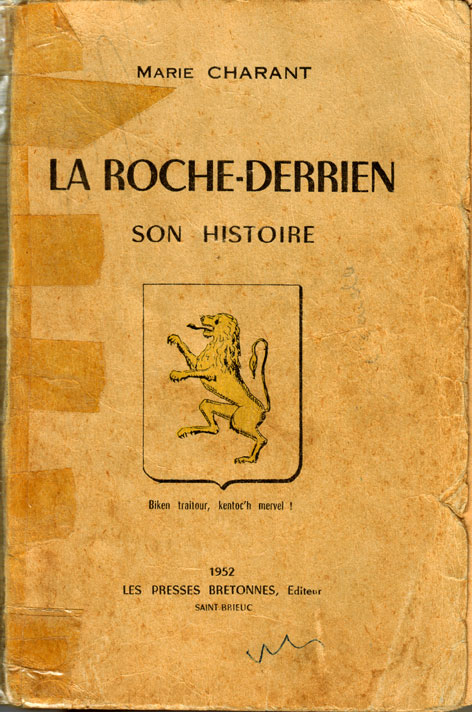
A ma chère Cousine Joséphine André, en religion Sœur Marguerite-Marie,
Rochoise d'origine et de cœur, je dédie
très affectueusement cette petite histoire
de notre ville natale.
![]()
Biographie de Marie CHARANT : en préparation.
Photographies et blasons : Jean-Claude EVEN
i AUX ROCHOIS ------------- C'est à vous, mes chers concitoyens, que j'ai pensé en écrivant cette petite histoire de la Roche-Derrien. Je l'ai rédigée spécialement pour vous dans la pensée et l'ardent désir que, connaissant mieux l'histoire de notre chère vieille ville, vous l'en aimiez davantage et la défendiez mieux contre le déclin et contre l'oubli. On sait les Rochois assez chauvins et on les taquine volontiers à ce sujet . «Bourk ar Roc'h» — «Roc'hiz kez tud a boan ag a gouraj», etc., etc., nous dit-on souvent avec raillerie ! et, peut-être même, avec une pointe de jalousie. Au cours d'une réunion récente quelqu'un a dit en ma présence, (oh ! plaisamment et sans aucune malice, je le reconnais) : Qu'est-ce que la Roche ?.,.. C'est grand comme un mouchoir de poche !» Un mouchoir ? soit... Mais il y a mouchoir et mouchoir. Il y a le grand mouchoir à carreaux fait de toile commune et le petit mouchoir de luxe fait de fin linon, orné de délicates broderies et de riche dentelle. Si notre ville est petite son passé est très grand et je crois qu'aucun de nos railleurs ne pourrait attribuer à sa cité une origine aussi haute et aussi noble ne fut celle de la Roche. Quels sont leurs titres ?... Où sont leurs armes ?... La Roche a les siennes et c'est un lion qui orne son blason : le lion le plus beau, le plus noble, le plus fier, le plus brave et le plus généreux des animaux ! Sait-on bien que c'est la bataille livrée à la Roche-Derrien, en 1347, qui décida du sort du Duché de Bretagne et en fit passer la souveraineté de la Maison de Blois à celle de Montfort ?... Car la bataille d'Auray qui consomma la défaite de la famille de Blois-Penthièvre, n'en fut qu'une conséquence, un corollaire. L'histoire de la Roche est pleine de grands souvenirs et ce sont ces souvenirs que j'ai voulu ressusciter pour vous, mes chers concitoyens. J'ai puisé mes documents aux sources les meilleures et les plus sûres 1° A la Bibliothèque Nationale à Paris dans les œuvres de Dom Lobineau, de Dom Morice, de la Borderie. 2° Dans plusieurs histoires de Bretagne. 3° Aux Archives de Saint-Brieuc. 4° Pour la période révolutionnaire j'ai eu la bonne fortune de me voir fournir par une personne très aimable, à qui j'en sais grand gré, des copies de pièces qu'elle avait eues en sa possession, pièces de l'époque qui existaient jadis à la Mairie de la Roche, mais qui, m'a-t-on dit, ne s'y trouvent plus. 5° Enfin, à tous les renseignements ainsi obtenus, j'ai joint quelques souvenirs personnels et le récit que me fit ma mère d'événements dont elle avait été le témoin (tel le choléra qui désola la Roche en 1867). Quant aux événements plus récents : la guerre de 1914-1918, celle de 1939-1940, vous pourrez juger par vous-mêmes de l'exactitude du compte rendu que j'en fais. Cette exactitude des faits est le seul mérite de cette petite histoire locale que j'ai écrite avec tout mon cœur de Rochoise, avec tout mon amour pour ma vieille ville natale et mon affection pour vous tous, mes chers concitoyens. Puisse mon récit vous plaire et atteindre surtout le but que je me propose : susciter un attachement toujours croissant à notre petite et si chère cité. M. CHARANT. |
![]()
i CHAPITRE PREMIER FONDATION DE LA ROCHE A LA RECHERCHE DES SOUVENIRS DU PASSÉ --------------------
Ainsi donc, sous son ancien nom de la Roche-Jaudi, la Roche-Derrien était antérieure au XIè siècle. Il y existait à cette époque un grand nombre d'habitations anciennes qui ont disparu successivement. Dans les siècles qui suivirent on en construisit d'autres.
Vendue après la mort de Mlle Hyène, par les héritiers de celle-ci, cette maison fut acquise par M. Jean-Marie Talguen, ancien minotier du Moulin de la Mer. Des personnes intéressées à la disparition de cette maison, avaient persuadé à M. Talguen qu'une construction si ancienne menaçait ruine, ... ------------------ (1) C'est sans doute par corruption que nous écrivons aujourd'hui Derrien avec deux r et Jaudy avec y. ... qu'elle s'effondrerait quelque jour sur les passants, lui causant de très graves ennuis et qu'elle recelait en outre un trésor qui, prétendaient-elles, y était caché. Pour ces raisons, mais . surtout alléché par la pensée d'y découvrir le trésor, M. Talguen la fit démolir, enlevant ainsi à la Roche, une maison qui était un joyau et le plus beau vestige de son passé. De trésor, bien entendu, il ne s'en trouva point, mais ce que l'on put constater à la démolition c'est que là maison était encore d'une solidité à toute épreuve et que les boiseries qui la composaient, depuis les poutres, faites d'énormes troncs de chêne, jusqu'au dernier croisillon de la façade, étaient encore sains et intacts, comme au premier jour. A gauche de l'habitation de Mlle Hyène, celle qu'occupé aujourd'hui la famille Savidan, compte dans les maisons les plus anciennes de la Roche. A droite dans la cour de l'ancien établissement de nos religieuses, devenu depuis école publique, existait un vieux bâtiment, aujourd'hui disparu, que nous, les anciennes élèves, nous appelions : « la vieille maison». Cette vieille maison fut, à la Roche, le berceau de la première école de filles, qui fut fondée en 1818 par les religieuses du Saint-Esprit. Elle était tout ce qui restait de l'ancienne maladrerie ou hôpital de la Roche. Et de là le nom breton de « Carden an hospital», (venelle de l'hôpital) donné encore aujourd'hui à la venelle qui conduit de l'angle de la pharmacie à la maison de M. et de Mme Le Bézu.
A côté de « la vieille maison» dont nous parlions plus haut, et dans là cour du même établissement, existait autrefois une chapelle dédiée à saint Eutrope; c'était la chapelle de l'hôpital; elle dut être construite à la même époque que lui. En 1613, des audiences y étaient tenue par le sénéchal Louis de Kermel. En 1700, Saint-Eutrope avait pour chapelain messire Ropers; en 1808 cette chapelle existait encore, elle fut ensuite détruite. Ce fut certainement pour en perpétuer le souvenir que la Supérieure de l'établissement de la Roche, Mère Saint-Michel, dite « Bonne Mère» fit construire un petit oratoire à Saint-Eutrope et choisit ce saint comme l'un des patrons de sa communauté. Au temps lointain de ma jeunesse, la cour actuelle de l'établissement était coupée par un mur qui. partant de la venelle, allait aboutir au point de jonction des deux bâtiments d'école, en faisant ainsi deux cours distinctes. Une porte percée dans ce mur, tout contre les bâtiments, mettait en communication les deux cours, et, à côté de cette porte, encastré dans le mur même, était un puits dénommé « Puits de St-Eutrope». A l'existence de ce puits se rattache un des souvenirs de mon enfance. Mère Saint-Michel, « Bonne Mère», désireuse de simplifier le service, et d'éviter à son personnel des allées et venues continuelles à travers la première cour, pour aller tirer au puits l'eau nécessaire aux besoins de son importante communauté, eut l'heureuse idée d'en amener directement l'eau à la cuisine où elle voulait faire placer une pompe. Pour cela, il fallait établir une canalisation, creuser une tranchée et quelle ne fut pas la surprise des terrassiers lorsqu'ils mirent à jour une prodigieuse quantité d'ossements et de têtes de morts ! Je vois encore, comme si c'était aujourd'hui, l'énorme pyramide que formaient ces restes humains dans la classe de la salle d'asile où on les avait respectueusement déposés, avant de les inhumer ailleurs. Ce fait, à l'époque où il se produisit — j'étais trop jeune — ne me causa d'autre impression que cette sorte de crainte respectueuse que suscite chez les enfants tout ce qui touche à la mort. Plus tard, en y réfléchissant, je me demandai s'il n'y avait pas eu là un cimetière où s'inhumaient les morts décédés à l'hôpital. Mais, outre qu'il serait difficile d'admettre qu'on eût pu établir un cimetière tout contre les bâtiments occupés par les malades — la vue n'en aurait pas été encourageante pour eux — une découverte analogue qui fut faite quelques années plus tard, autour de la chapelle de Pitié, où il .n'y avait jamais eu de cimetière, m'ouvrit d'autres horizons. Les restes trouvés autour de cette chapelle 'étaient-ils j pas ceux des compagnons, et des partisans de Charles de Blois, tombés là en défendant sa cause ?... Et, par une association naturelle d'idées, ma pensée se reporta sur la découverte faite chez les Religieuses. N'aurait on pas creusé jadis, entre Pitié et la Maladrerie, où le combat fut particulièrement intense, une immense fosse commune où on aurait déposé les corps des soldats tombés à la bataille de la Roche-Derrien ?... J'ignore le nombre de ceux qui périrent du côté de Montfort, mais je sais que du seul parti de Charles de Blois il en fut tué plus dé 4000, et ces corps évidemment ne restèrent pas sans sépulture.
Descendons la rue de la Fontaine dont la plupart des maisons sont anciennes, quoique de construction beaucoup plus récente. Là première ruelle que nous y rencontrons à notre gauche, nous conduit à une petite place qui était celle du pilori. Mais nous doutions-nous, nous tous Rochois, qui sommes si souvent passés devant lui s'ans le remarquer, que ce pilori — ou du, moins une partie de ce qui fut le pilori — existait encore ?... Remarquez celle énorme pièce de bois qui se dresse verticalement contre le mur d'entrée de la propriété de M. Savidan; c'était là un des montants du pilori et il porte encore ses anciennes ferrures, le portail d'entrée y a été fixé. L'autre montant a dû disparaître lorsque fut créée cette entrée, mais la trace en était encore visible sur le sol, il y a peu de temps (1). -------------------------------- (1) Le second montant du pilori vient de disparaître par suite d'une nouvelle modification dans l'entrée de la propriété de M. Savidan. Revenons sur nos pas et poursuivons notre descente de la rue de la Fontaine. A droite, à l'endroit qu'occupe aujourd'hui la maison de Mlle Eugénie Guyomar, j'ai connu, dans mon enfance, une construction qui, par son architecture, son étage surplombant et les boiseries de sa façade rappelait, en dimensions plus restreintes l'habitation de Mlle Hyène. Deux pas plus loin, à gauche, deux maisons attirent spécialement l'attention. Ce sont celles qui confinent, à la fontaine aujourd'hui couverte de Sainte-Catherine, dont l'eau est maintenant puisée à l'aide d'une pompe. Ces deux maisons, qui échappent à l'alignement actuel, font saillie sur la rue. Le sol des pièces du rez-de-chaussée, est en contre-bas de la rue; on y accède par des marches. Dans ces deux maisons, creusés à même le sol qui est de terre battue, sont des trous qui contiennent de l'eau. Était-ce là primitivement la fontaine Sainte-Catherine ? Et l'eau, qui, au temps de ma jeunesse, se puisait encore dans la fontaine créée extérieurement, un peu plus bas, en provenait-elle ?... C'est fort probable, car un droit de 6 francs par an, dit droit de Sainte-Catherine, était payé par les habitants du quartier au propriétaire de ces maisons. Ce droit s'est éteint avec Catherine Capitaine qui a été la dernière à l'acquitter. En face de ces deux maisons,
dans un terrain à M. Julien Loyer, existe une excavation,
désignée en breton sous le nom de « Toul Mary Brozoz»
« Trou de Marie d'Angleterre'». De Arrivons au quai. Nous y trouvons la maison de M. Joseph Hamon qui en a modifié la façade, lui faisant perdre le cachet d'ancienneté que je lui ai connu. Cette maison fût jadis une communauté religieuse habitée par des moines, chapelains des seigneurs de la Roche. Ils accédaient au château par des sentiers en lacets tracés dans leurs jardins, sur le flanc de la colline du Calvaire. Si, tournant l'angle de cette maison, nous prenons le raidillon qui mène au Calvaire, nous trouvons, immédiatement à notre droite, un grand portail, jadis plein, aujourd'hui à claire-voie, qui donnait accès à la cour de la Communauté. A gauche de ce portail, un petit bâtiment, dont la porte d'entrée était percée dans le pignon, était certainement la loge du concierge et permettait de surveiller les entrées et les sorties de la cour. Ce bâtiment a été agrandi depuis et sa porte d'entrée percée dans le corps même du logis. A droite du portail, s'élève un mur séparant la première cour, qui était celle des communs, d'une cour plus petite qui était probablement celle de la clôture, comme l'indique un judas percé dans la porte qui mettait en communication les deux cours. Ce judas, je l'ai vu bien souvent s'ouvrir pour vérifier l'identité des visiteurs dont nous étions, ma mère et moi, lorsque nous allions voir Mlle Emma Prigent, ancienne propriétaire de cette maison. Arrivons à la rue de l'Eglise. La seigneurie de la Roche qui fut d'abord possédée par les seigneurs du même nom, devint au XIVè siècle, propriété de Charles de Blois qui, en 1365, la donna, en récompense de ses services, à Bertrand Duguesclin, après la levée-du siège de Rennes.
La maison que le héros breton vint habiter ici, se voit encore, quoique modernisée depuis, en face de l'église : c'est celle qu'habité aujourd'hui Mme Olivier Chrec'hriou. Il y a très peu d'années, avant les transformations, qu'y fit faire Mme de la Villeguérin, on voyait encore, de la venelle qui mène au presbytère, un vieux bâtiment, percé d'une étroite fenêtre qui était celle près de laquelle travaillait Tiphaine Raguenel, la savante femme de Duguesclin. Cette fenêtre a disparu; le mur dans lequel elle s'ouvrait a été démoli et le vieux bâtiment, qui était à une certaine distance du mur d'enceinte, agrandi, fait corps aujourd'hui avec la nouvelle construction qui vient s'appuyer sur lui. Ce fut dans cette maison que
Tristan (de Vitré, je crois) vint voir son ami Bertrand,
qu'il trouva, dit-on, occupé sous un hangar au
dépècement d'un verrat qu'on venait de tuer et Puisque nous parlons de
Duguesclin, peut-être n'est-il pas superflu, peut-être
même est-il indiqué de dire un mot de Tiphaine Raguenel,
sa compagne. « Pour faire son éloge en un mot, a
écrit dom Lobineau, on peut dire qu'elle était digne d'un
si grand homme; elle fut honorée de tous les seigneurs,
qui la regardèrent avec toute la vénération due aux
lumières extraordinaires de son esprit et à la
générosité héroïque de son cœur.» **************** |
![]()
CHAPITRE II SUITE DU CHAPITRE PRÉCÉDENT : NOTRE ÉGLISE. -- NOS CHAPELLES -------------------- Nous avons vu les demeures des hommes, passons maintenant à celle de Dieu, à notre EGLISE Elle est ancienne et fort remarquable, à part une aile, dite chapelle du Château, dont la construction est postérieure à celle de l'église et porte la date de 1829. Pourquoi cette dénomination de chapelle du Château ? Elle était probablement réservée aux seigneurs de la Roche lorsqu'ils assistaient aux offices paroissiaux et peut-être leur servit-elle aussi de lieu de sépulture. Un fait me porterait à le croire : lorsqu'on y creusa la fosse d'un de nos curés (celle de M. Parquer, en 1890) on y trouva une tête humaine, encore ornée d'une magnifique chevelure blonde qui semblait être celle d'une jeune femme ou d'une jeune fille. Une femme de la Roche qui était présente à l'ouverture de cette fosse, prit cette tête, la mit dans son tablier et la porta au cimetière. Elle nous raconta ce fait, à ma mère et à moi, et nous lui reprochâmes d'avoir agi sans consulter les autorités; mais la chose s'était passée depuis quelque temps déjà, il n'y avait pas à y revenir et nous n'en dîmes rien.
carte postale. 1920. Toutes les parties de notre église, à part cette chapelle du château sont de style ogival et roman, circonstance qui donne à penser que sa construction remonte au XIè siècle, époque à laquelle ce style était en honneur, et qu'elle serait due à l'initiative et peut-être (du moins en partie) aux libéralités de Derien. Et, ce qui donne du corps à cette hypothèse, ce sont les trois têtes en relief que l'on voit au-dessus du chœur, du côté de l'Évangile et presque à la hauteur de la voûte; ces têtes sont, celles de Derien, le fondateur de la Roche, que surmonte le dais comtal, de sa femme Amice et d'Eudon, leur fils. «Notre église se compose d'une nef centrale, flanquée de bas-côtés de même longueur, séparés de la nef par des arcades ogivales se rapprochant du plein cintre. «A l'angle nord, du bas-côté gauche, on remarque une tourelle solidement construite. Elle renferme un escalier en pierre qu'on peut apercevoir par une barbacane. A l'entrée de cet escalier est une pierre gravée sur laquelle on distingue une épée, avec ces caractères : «Gaufrid». Ne serait-ce pas là la pierre tombale de Geoffroy de Tournemine, tué à la bataille de la Roche-Derrien en 13417 ? - - On ignore la destination de cet escalier mais on peut conjecturer qu'il conduisait à quelque souterrain placé sous l'église. Ces souterrains existaient et ont été parcourus il y a un certain nombre d'années. Il est probable que l'escalier conduisait aussi à l'autel Saint-Joseph. «Le vestibule de notre église, ou porche, est voûté comme l'église elle-même et orné de galeries latérales, divisées en compartiments occupés jadis par des statues gothiques. «Le bénitier placé dans le vestibule est fort curieux et mérite d'attirer spécialement l'attention des antiquaires : de forme octogonale, il porte sur toutes ses faces des figures qui ont quelque peu subi l'usure des siècles. Son origine paraît remonter à une très haute antiquité. Des restes de goupilles de fer, scellées dans la pierre, permettent de croire qu'il eut autrefois un couvercle et qu'il a pu servir de baptistère. Certains le disent du Xè siècle; il est peut-être plus ancien.
Les stalles du chœur sont en bois du début du XVIIè siècle. Derrière ces stalles, du côté de la chapelle du château, sont cinq panneaux en bois sculpté du XVIè siècle. La porte de l'ancienne sacristie remonte à la même époque (XVIè siècle). La chaire est du XVIIIè siècle. (1) Le passade entre guillemets de la page 25 à la page 27 est la copie de renseignements qui m'ont été fournis par M. le chanoine Turmel, ancien curé de La Roche-Derrien, de regrettée mémoire. ----------------- Du côté de Évangile, un autel latéral, en bois, du bois, du XVIIè siècle, est dédié à saint Joseph dont la statue et celle de saint Éloi occupent les entrecolonnements. D'élégantes colonnes, surmontées de chapiteaux corinthiens, en soutiennent l'entablement, au-dessus duquel quatre anges supportent deux corbeilles de fleurs. Du côté opposé (côté de l'Épître), est l'autel de saint Yves. Au milieu du retable est un joli tableau du saint. L'autel lui-même, très large et très haut est terminé par un pilastre sur les deux côtés. Plus au milieu deux grandes colonnes supportent un entablement, surmonté d'un fronton, au-dessus duquel est une gloire. Les deux statues qui ornent cet autel sont celles de saint Yves et de saint Alphonse de Liguori. Notre église possède un chandelier d'autel en fer forgé du XVè siècle et des fonts baptismaux qui sont ses contemporains (XVè siècle).
Ma mère me racontait que, lorsque fut désaffecté ce cimetière, et qu'on eut exhumé les restes de ceux qui y reposaient, on organisa à la Roche une grande procession, dite procession des reliques, à laquelle prirent part tous les habitants, chacun d'eux, chargé de porter au nouveau cimetière les restes de ceux des siens qui avaient été relevés dans l'ancien. Un rideau d'ifs clôturait cet ancien cimetière du côté où fut jadis l'école des frères (terrain actuel de la Mairie). Il était l'habitat de nombreuses chouettes qui y soufflaient lugubrement le soir. Et c'était la terreur des enfants, voire même de nombreuses grandes personnes qui croyaient - - tant on était superstitieux à cette époque -- que c'étaient là les gémissement des âmes en peine de ceux dont les corps avaient été déposés dans ce cimetière.
La Roche possède une troisième chapelle, celle du Calvaire, édifice moderne (style XVè siècle), érigée en 1867, sur la motte du château. Cette chapelle, qui était celle des Enfants de Marie de la communauté de Sainte-Anne, à Lannion, fut acquise pour notre ville par la Fabrique et M. le docteur Tily, alors maire de la Roche. Les pierres numérotées à leur départ de Lannion, permirent de la reconstruire ici, comme elle avait existé là-bas.
Chapelle du Calvaire depuis le clocher de l'église (JC Even) |
![]()
DÉCOUVERTES FAITES A LA ROCHE-DERRIEN UN MOT DU CHATEAU NOIR -------------------
En 1854 on a trouvé, près de notre ville, un poignard en bronze et une épée gauloise de l'époque celtique. Le poignard est dans le cabinet de M. de Boisboissel, à Guingamp, l'épée est au Musée de Saint-Germain. De l'époque romaine, il est resté ici de nombreuses substructions, telles sont celles qui soutenaient les fondations de notre Château-fort; appareil en maçonnerie, composé de plusieurs couches de pierres noyées dans un mortier de chaux et de sable. On y a recueilli plusieurs médailles de la famille Antonine qui ont été remises à M. Guillou, propriétaire du terrain; monnaies de Posthume et de Marus, petits bronzes trouvés dans un jardin voisin. A deux cents pas de la ville, autres substructions au lieu dit Bonrrède, au milieu de six hectares jonchés de briques, tuiles à rebord, ciment et autres débris. Plusieurs champs, sur la rive droite du Jaudy, entre la Roche et le pont de Tréguier, portent le nom de «Parc ar c'hastel» (champ du château), et recèlent aussi des substructions et des débris gallo-romains. Dans un de ces champs on a trouvé des urnes cinéraires qui étaient entre les mains de M. Connan, propriétaire du terrain.
Sous les mêmes ruines, celles d'une ancienne tour du château, (qui en était certainement le donjon et dominait le petit bras de mer profondément encaissé), au milieu d'une enceinte circulaire de 30o mètres de circonférence environ — ce que nous appelons aujourd'hui le Calvaire — on remarquait autrefois une ouverture hexagonale fort profonde dont la destination n'est pas connue. Elle conduisait, peut-être, disent les historiens, à des souterrains ménagés sous la tour, pour servir de retraite, ou bien à des cachots, creusés profondément dans le roc, pour étouffer les plaintes des vassaux qu'atteignait la Haute Justice que possédaient les seigneurs de la Roche. En septembre 1843 on a découvert sous les murs de cette tour, un caveau rempli de poteries anciennes et de boulets de pierre gros comme des bombes. Tout cela a été dispersé : il n'en n'est resté que les quatre boulets qui sont en haut des marches du Calvaire, il y en a quelques autres dans des jardins de la ville. Tous proviennent des machines de guerre de Charles de Blois. Sous les ruines de la même tour ont été découvertes également des pièces de monnaies d'argent. J'en possède quelques-unes qui me viennent de mon grande père. Toutes remontent à une époque reculée. L'une d'entre elles, que j'ai malheureusement perdue, portait la date de l'an 800 et les lettres Roll... dont la suite était illisible. Cette date qui correspond à celle du couronnement de Charlemagne comme empereur d'occident, et ces lettres m'avaient fait penser que c'était peut-être là une pièce de Rolland de Roncevaux. Je savais d'ailleurs que ce Rolland avait été chargé par son oncle de venir percevoir les impôts sur les Marches de Bretagne, ce qui pouvait expliquer la présence de cette pièce à la Roche. Mais les seigneurs avaient-ils le droit de battre monnaie à cette époque ?... Je me suis renseignée; la réponse a été négative. J'ignore donc de qui était cette pièce. Il en est une autre qui porte deux couronnes et ce fait m'avait frappée. Pourquoi deux couronnes ? ... J'en ai trouvé l'explication à la Bibliothèque Nationale, à Paris, où j'ai puisé la plupart de mes renseignements : Yolande de Dreux, qui était veuve du roi Alexandre III d'Écosse, lorsqu'elle épousa en secondes noces le duc Arthur II de Bretagne, fut autorisée exceptionnellement, comme ex-souveraine, à joindre sa couronne à celle de son époux. Cette pièce est donc certainement d'Arthur II et de la duchesse Yolande. Une troisième pièce porte l'effigie un peu confuse d'un animal qui est probablement le lion rochois. Les autres pièces portent des Croix de Malte et l'une une croix plus grande qui semble être celle des Croisés et nous verrons, en effet, que des seigneurs de la Roche prirent part à des expéditions en Terre Sainte.
Situé en face de la tour du château-fort, et pour ainsi dire à son niveau, le Château-Noir en facilitait l'attaque. Enfin, un vaste champ, appelé le champ du Mézeau, situé entre les hauteurs de Bellevue, le cimetière actuel, Pitié et la Maladrerie, rappelle la célèbre bataille de 1347 qui fut si fatale à Charles de Blois. Là, aussi, ont été trouvées des pièces de monnaie et un éperon de fer appartenu à une époque très reculée. |
![]()
i CHAPITRE IV PARTIE PUREMENT HISTORIQUE LES PREMIERS SEIGNEURS DE LA ROCHE ----------------
En 1154, Derien, seigneur de la Roche, fonda, nous dit l'historien Ogée, le prieuré de Sainte-Croix de Guingamp, qu'il donna aux moines de Saint-Mélaine de Rennes. Ce fait est contesté par certains auteurs, qui attribuent la fondation de ce prieuré à Etienne de Penthièvre et à sa femme Havoise de Guingamp; mais il semble, cependant, que l'assertion d'Ogée soit exacte, puisqu'une rente de cent sous par an fut payée au prieuré de la Roche-Derrien par le prieur de Guingamp dans les années qui suivirent la fondation. Ceci suppose une attache entre les deux prieurés qui existaient encore en 1256. Celui de la Roche avait dû être fondé vers 1150. - - Ce qu'il y a de certain, c'est que la foi était très vive a cette époque et que nul autre siècle ne fut plus fertile en fondations dues à la piété. La famille de Penthièvre donne elle-même quelques évêques à EGLISE et de nombreux religieux et religieuses aux monastères. En 1218, Eude ou Eudon de la Roche-Derrien, laissant là sa femme et ses deux pupilles, enfants de son oncle Eudon de Quimper, qu'il élevait, partit pour la Terre-Sainte, confiant en son absence sa famille et l'administration de ses biens à Geoffroy, vicomte de Rohan. Le testament qu'il fit, à son départ pour Jérusalem, cache, sous une apparente sécheresse, une très profonde émotion et une grande délicatesse d'âme : «J'ai livré, dit-il, à Geoffroy, vicomte de Rohan, toutes mes terres de Bretagne, pour 600 livres de monnaie courante, qu'il a remises à mon départ pour Jérusalem. J'en excepte toutefois la dot et le douaire de ma ce femme Vilanie. Je lui ai remis aussi le fils et la fille d'Eudon de Quimper, mon oncle, ainsi que mon château de la Roche, sous la condition qu'il fera garder ce château avec soin et qu'il prendra soin aussi des enfants d'Eudon. — Si je meurs en mon voyage, et si le fils d'Eudon venait aussi à mourir, Geoffroy conclura le mariage d'un de ses frères avec la fille d'Eudon. Tous les revenus et produits de ma terre seront consacrés à l'extinction de ma dette. Le vicomte retiendra d'abord les justes frais qu'il aura faits pour moi. Si, par la grâce de Dieu, je reviens de Jérusalem, et que ma dette ne soit pas entièrement éteinte, je donnerai caution suffisante pour rentrer en possession de mon bien. Si les revenus ont été supérieurs au montant de ma dette, le vicomte conservera la moitié de l'excédent et me rendra en paix l'autre moitié, ma terre, le château et les enfants. Je veux que ce testament soit fidèlement exécuté et, pour qu'il soit valable à jamais, j'y ai apposé mon sceau" (1218). Quelle loyauté, quelle délicatesse de sentiments dans cet écrit ! Quelles expressions peuvent répondre aux nobles pensées qui agitaient cet Eudon de la Roche-Derrien ? Il revint de Jérusalem, mais, en son absence, Pierre Mauclerc, prince rusé et despotique, avait mis la main sur la Seigneurie et le château de la Roche-Derrien. En effet, quatre ans avant le départ d'Eudon de la Roche-Derrien pour Jérusalem, Pierre de Dreux, dit Pierre Mauclerc était devenu duc de Bretagne par son mariage avec Alix, héritière du duché. Il résolut de centraliser le pouvoir, d'accroître son autorité, ce qui ne pouvait se faire sans amoindrir celle de ses barons. Il entra donc en lutte contre eux, s'empara de leurs biens et, par une série de négociations financières, acquit les autres seigneuries importantes qui échappaient encore à sa domination. La Roche-Derrien était au nombre de celles-ci. Cette seigneurie appartenait alors à Plaisou, fille naturelle de Conan de la Roche, et à son mari Olivier. Ceux-ci laissèrent par devoir de fief, leur château de la Roche-Derrien au duc Pierre, lorsqu'il faisait la guerre à ses barons de Bretagne. S'il était du devoir de Plaisou et de son mari de livrer en temps de guerre, leur château au duc, il n'en était pas moins du devoir du duc, la guerre finie, de rendre la place à qui elle appartenait; cependant, il la garda jusqu'à sa mort, rattachant ainsi à la couronne, contre toute justice, une seigneurie qui en avait été détachée pour être donnée par Alain III au père de notre Derrien et par celui-ci à ses descendants. Après la mort de Mauclerc, Plaisou, devenue veuve, intenta un procès au duc Jean Ier, dit le Roux, fils et successeur de Pierre Mauclerc, et le fit ajourner à la cour du roi. Ce procès eut un grand retentissement et dura longtemps. Plaisou mourut avant d'en voir la fin. Il en fut de même de son fils Alain. Jeanne, sœur et héritière d'Alain, continua l'action. Le duc lui opposait que ni sa mère ni elle n'étaient nées de mariage légitime et qu'Alain, frère de Plaisou, son oncle, mort sans enfant, après l'an 1287 et auquel cette seigneurie devait appartenir, l'avait perdue, par jugement de la cour de Bretagne, contre plusieurs seigneurs qui y prétendaient et avaient traité de leurs droits avec lui. Malgré toutes ces raisons, le Duc de Bretagne fut condamné par le Parlement à rendre la Roche-Derrien à ses possesseurs et à en restituer tous les fruits qui se montaient à 80.000 livres. En 1811, Bertrand II de Saint-Pern
commandait la place forte de la Roche-Derrien, au nom du
duc Arthur II de Bretagne, époux de Marie de Limoges. |
![]()
CHAPITRE V JEAN III. — CAUSES DE LA GUERRE DE SUCCESSION DE BRETAGNE. CHARLES DE BLO1S ET JEAN DE MONTFORT, LEUR LUTTE. SIÈGE ET PRISE DE LA ROCHE-DERRIEN PAR NORTHAMPTON. -------------------------------
Jean III avait épousé en premières noces Isabelle de Valois, sœur de Philippe VI de Valois, roi de France. Après son veuvage et un second mariage il était resté très attaché à son ex-beau-frère Philippe et aux intérêts de la couronne de France. Jean III n'eut d'enfants d'aucun de ses mariages, mais il avait deux frères germains, c'est-à-dire nés, comme il l'était lui-même, d'Arthur II et de Marie de Limoges. Ces deux frères du duc Jean moururent avant lui, Pierre, le plus jeune, sans postérité; Guy laissant une fille, Jeanne de Penthièvre. Si Guy avait vécu, il fut devenu, en vertu de son droit d'aînesse, et sans contestation possible, héritier du duché de Bretagne. Lui mort, et la loi salique n'étant pas en vigueur en Bretagne, sa fille Jeanne qui le représentait dans la succession, devenait héritière présomptive du duché. Mais Jean III avait aussi un demi-frère, Jean de Montfort, né d'un second mariage de leur père avec Yolande de Dreux, l'ex-souveraine Écosse Jean de Montfort, alléguant qu'il était demi-frère du duc régnant, plus proche par conséquent d'un degré que Jeanne de Penthièvre, qui n'était que leur nièce à tous deux, émit quelques prétentions à l'héritage du duc. Jean III, qui le sut, prévoyant les maux qui résulteraient pour la Bretagne d'une rivalité entre son frère et sa nièce, résolut, pour y couper court, de laisser après sa mort son duché de Bretagne à Philippe de Valois, roi de France. Il y mit cependant cette condition que Jeanne de Penthièvre, ou les héritiers qui pourraient naître d'elle, recevraient de Philippe VI une autre seigneurie importante : il fut convenu qu'on lui donnerait le duché d'Orléans. D'autre part, pour éloigner Jeanne de la Bretagne et éviter toute cause de conflit, Jean III et le roi de France négocièrent son mariage avec Charles, fils aîné du roi de Navarre, qui fut plus tard connu dans l'histoire sous le nom de Charles le Mauvais. Or, en 1337, quand eurent lieu toutes ces négociations, Jeanne de Penthièvre était encore trop jeune pour avoir des enfants, elle ne pouvait atteindre cet âge que dans un ou deux ans. Quant à Charles de Navarre, de beaucoup plus jeune qu'elle, on ne pouvait espérer qu'il pourrait devenir père avant au moins 13 ou 14 ans. Lorsque les seigneurs bretons eurent connaissance de ces dispositions prises par leur Duc, ils s'y opposèrent formellement : ils entendaient maintenir l'indépendance du duché, le garder à Jeanne et assurer, aussitôt que possible, par le mariage de celle-ci et une prompte descendance, des héritiers, après elle au Duché de Bretagne. Devant l'opposition de ses barons, Jean III dut céder, revenir sur les négociations faites avec le roi de Navarre, remettre Jeanne en possession de ses droits et ce fut alors que, d'accord avec le roi de France, il décida de marier sa nièce à Charles de Châtillon, duc de Blois, neveu de Philippe VI, par sa mère qui en était la sœur. Mais remettre Jeanne en possession de ses droits c'était réveiller les prétentions de Jean de Montfort. A la mort de Jean III, la guerre, connue dans l'Histoire sous le nom de Guerre de Succession de Bretagne, éclata entre les deux rivaux.
Jean de Montfort, qui avait été élevé en Angleterre et qui était très Anglais de cœur, fit appel à Édouard III. Les deux souverains, qui étaient déjà en guerre, trouvèrent l'occasion favorable pour intensifier leur lutte, en la portant sur un second terrain, et ce fut ainsi que la Guerre de Succession de Bretagne devint un épisode de cette fameuse guerre qui, pendant cent ans, mit aux prises Anglais et Français.
Les Rochois repoussèrent vigoureusement le premier assaut et résistèrent non moins vaillamment pendant deux jours à un second assaut. Mais l'incendie d'une des portes de la ville par les Anglais, les mit dans la nécessité de capituler. Ils députèrent vers Northampton Hue Cassiel, le Commandant de la Place. Northampton, qui avait été frappé de la bravoure de cet officier, consentit à ce qu'il sortit de la ville avec toute sa garnison. La même faveur fut accordée à Hue Arrel, à l'évêque de Tréguier, qui se trouvait dans la Place, à Raoul de la Roche et à tous ceux qui se trouvaient dans la ville qui fut ensuite livrée au pillage. Les Anglais trouvèrent à la Roche un très riche butin. Ils s'emparèrent notamment de 300 à 400 tonneaux de vins de France et de 1 à 14 tonneaux de vins d'Espagne qui appartenaient à des marchands de ces nations, car, à l'époque qui nous occupe, notre bras de mer n'était pas envasé comme il l'est de nos jours et les navires y abordaient pour y apporter les marchandises de l'étranger. Dans l'assaut livré à la Roche par Northampton, l'église, dédiée alors à Notre-Dame, fut fort endommagée. Une bulle de 1389, indique qu'elle avait alors besoin de grosses réparations et accordait des indulgences à cet effet. Northampton, après avoir pillé la Roche-Derrien, y laissa une garnison anglaise et se dirigea sur Lannion dans l'espoir de prendre Morlaix et d'entrer dans le Léon pour en faire la conquête. La garnison anglaise de la Roche, après la reddition de la ville à Northampton, était commandée par Richard Toussaint, qui est le même, il me semble, que Froissard nomme Tassard de Guînes; mais il semble avoir été mal renseigné sur la prise de la Roche-Derrien. Ce Toussaint, après avoir tenté à plusieurs reprises de prendre ... (1)Monseigneur de Boisboessel. ... Lannion, traita avec deux soldats de la garnison qui lui en ouvrirent les portes.
Les Anglais tuèrent aussi Geoffroy de Kerrimel avec plusieurs autres chevaliers. «Ils prirent les sires de Coëtuhan, Rolland Philippe, sénéchal de Bretagne pour Chartes de Blois et Thibaud Méran, docteur en droit, lesquels ils firent marcher, chargez de vin, en cotte et nus-pieds jusqu'à la Roche-Derrien, emmenant avec eux un grand nombre d'habitants, nobles et roturiers, avec un riche butin.»
|
![]()
CHAPITRE VI SUITE DE LA LUTTE ENTRE CHARLES DE BLOIS ET JEAN DE MONTFORT. CHARLES DE BLOIS VEUT REPRENDRE LA ROCHE-DERRIEN, Y LIVRE BATAILLE ET EST VAINCU. -----------------
Son premier soin, en arrivant sous nos murs, fut de distribuer les postes de combat. II plaça le meilleur et le plus important d'entre eux sur la rive gauche du Jaudy, dans un lieu nommé le Placis Vert (Place Verte), certainement le Chef du Pont actuel, point qui lui paraissait le plus vulnérable et par lequel il pensait devoir être attaqué. Ce point commandait, en effet, les routes de Bégard et de Lannion, et défendait l'entrée du pont qui, seul alors, donnait accès à notre ville. Aux troupes qu'il avait placées là, Charles donna l'ordre de "n'en bouger, ni à cor ni à cri", ni sous quelque prétexte que ce fût. Il savait que des troupes anglaises, envoyées par Jean de Montfort au secours des Anglais de la Roche, se reposaient alors à Bégard, avant de l'attaquer et de là l'ordre donné aux troupes du PIacis Vert. Ce fut un ordre malheureux, car, trompant toutes les prévisions de Charles, ces Anglais prirent des sentiers détournés à travers bois, passèrent la rivière au Pont Aziou et, le moment venu, devaient accéder à la Roche par un autre côté. Toutes ses dispositions d'attaque étant prises, Charles de Blois fit agir ses machines de guerre qui étaient au nombre de neuf et si puissantes qu'elles lançaient sur notre ville des pierres de 300 à 400 livres. Une de ces pierres tomba par hasard sur la maison de Richard Toutesham, le commandant anglais de la Place, dont la femme venait de mettre un enfant au monde. Cette dame fut si épouvantée qu'elle supplia son mari de capituler. La ville entière le désirait elle-même, car toutes les maisons avaient beaucoup souffert et la position ne semblait plus tenable. On envoya donc vers Charles de Blois pour traiter, mais le Duc refusa avec hauteur d'entrer en négociations, espérant battre sans peine les troupes que l'intrépide comtesse de Montfort envoyait aux assiégés. Ce fut une nouvelle faute. Devant le refus du duc Charles de traiter, les Anglais assiégés dans la Roche redoublèrent d'efforts et ils eurent bientôt la satisfaction d'apprendre qu'il leur arrivait un secours de 8.000 hommes d'infanterie et de 1,000 hommes de cavalerie, sous la conduite de Thomas d'Ageworth, de Tanguy du Châtel et de Jean Hartwel. C'étaient les troupes de Bégard. Elles arrivèrent au camp de Charles de Blois placé entre les hauteurs de Bellevue, le cimetière actuel, le Moulin et la Maladrerie, par une nuit si noire et dans un tel silence des troupes, que, ni les Sires de Derval et de Beaumanoir, ni Robert Arrel, ni les autres chevaliers préposés à la garde ne s'aperçurent d'abord de la présence des Anglais. Un léger bruit attira cependant l'attention du guet : l'alerte fut donnée et les avant-postes en vinrent aux mains avec les Anglais. On se battit d'abord dans l'obscurité et la lutte ne fut, à son début, qu'une succession de duels et de corps à corps dans lesquels les hommes d'un même parti s'attaquaient souvent entre eux, croyant avoir affaire à l'ennemi, Mais les troupes anglaises avaient un avantage sur celles de Charles de Blois : elles avaient un mot de reconnaissance qui leur permettait d'interrompre la lutte en cas d'erreur; celles de Charles de Blois n'en avaient aucun et continuaient à se battre entre elles. Au premier moment, cependant, D'Agewort est pris, fait prisonnier, puis délivré par les siens et repris une seconde fois par Charles de Blois, accouru en personne sur le champ de bataille. Le Sire de Laval, le Sire de Rohan et plusieurs autres seigneurs se procurèrent quelques flambeaux et se battirent à leur lueur avec un courage vraiment digne de la victoire. Mais le Commandant anglais de la Place, informé de ce qui se passait, fit une sortie à la tête de 500 hommes, armés de haches, perça la ligne de bataille de Charles de Blois et fit un horrible carnage dans les rangs de ses soldats. Pris entre deux feux, attaqué en avant et en arrière, et déjà entouré d'illustres morts, Charles battit en retraite jusqu'au lieu dit le Mézeau. Là, adossé contre un moulin à vent, il se défendit encore pendant quelque temps; mais, atteint de dix-huit blessures, perdant son sang en abondance, ne pouvant plus se soutenir, il fut contraint de se rendre. Il ne voulut pas le faire à un Anglais; il remit son épée à Robert du Châtel, chevalier breton du parti de Montfort (18 juin 1347).
Comme le Duc de Bretagne dut regretter alors l'ordre malheureux donné aux troupes du Placis Vert !... La présence de ces troupes d'élite eut certainement changé la face des choses et mué la défaite en victoire; mais, fidèles à la consigne reçue, et ignorant ce qui se passait sur les autres points, elles ne bougèrent pas. En apprenant la défaite de Charles de Blois, les Français, ses alliés prirent la fuite, laissant sur le champ de bataille, au nombre des morts : Guy X de Laval, les Sires de Montfort, de Chateaubriand, de Derval, de Rougé, de Quintin, de Ruis, de Rieux, de Machecoul, de Rostrenen, de Lohéac, de la Roche, de la Jaille, Guillaume de Quintin, Geoffroy Tournemine, Thibaut de Boisboissel, etc., etc., et plus de 4.000 hommes d'armes.
Notre sol rochois est mêlé de la poussière de ces illustres morts. Ils n'ont pas laissé seulement ici leurs corps; ils ont dû nous léguer aussi quelque chose de leur âme et de leur vaillance, et c'est peut-être pour cela que le Rochois d'aujourd'hui, actif et brave, est toujours le premier à courir au danger, à porter secours en cas de sinistre ou de catastrophe. "Par le massacre de la Roche-Derrien, par la capture de son chef", dit M. Luce, "le parti de Blois se sent frappé au cœur". "Ce désastre, la ruine financière et militaire qui en est la conséquence, la captivité de Charles de Blois vont changer la face des choses en Bretagne : Liée par les trêves et plus encore par le précieux gage qu'une défaite vint de mettre entre les mains des vainqueurs, Jeanne de Penthièvre, épuisée d'ailleurs par l'énorme rançon qu'il faut recueillir pour obtenir la mise en liberté de son mari, est désormais hors d'état de prendre l'offensive contre ses adversaires." Faut-il ajouter avec le même auteur . "Défaite glorieuse, mais irréparable dont le parti de Blois ne devait jamais se relever." Tombé sur le champ de bataille, Charles de Blois, relevé par les soldats anglais, fut porté par eux en son château de la Roche où, n'avait pas rejeté les propositions de paix, il se rait rentré en vainqueur, où il arrivait vaincu et prisonnier. D'Ageworth le traita d'abord avec beaucoup d'humanité; il le fit débarrasser de son armure et déposer sur un bon lit de plume, puis il vint lui même le visiter. Mais, ayant appris plus tard que le Duc de Bretagne avait refusé de se rendre à un Anglais, il émit la prétention que Charles se rendit à lui. Le noble vaincu s'y refusa. Alors d'Ageworth le traita avec la dernière rigueur : il le fit dépouiller de ses vêtements, jeter nu sur de la paille et se retira en laissant près de lui un linceul. De la Roche-Derrien, Charles de Blois fut conduit à Vannes, où il passa un an à se remettre de ses blessures, et de là fut envoyé en Angleterre où il fut retenu prisonnier jusqu'en 1352. Sa femme, Jeanne de Penthièvre, le remplaça dans la lutte qu'elle conduisit avec une vaillance digne d'un grand homme de guerre. Jeanne de Flandres, comtesse de Montfort, sa rivale, " femme au courage d'homme et au cœur de lion», disent les vieux chroniqueurs, dirigeait elle même le parti de Montfort, depuis la captivité de son époux, fait prisonnier par les Français, tout au début de la guerre, au siège de Nantes. La présence de ces deux femmes également énergiques, à la tête de leurs armées respectives, a fait donner à cette lutte des maisons de Blois et de Montfort, le nom de guerre des deux Jeanne. |
![]()
JEANNE DE PENTHIÈVRE POURSUIT LA LUTTE, PIERRE DE CRAON ET ANTOINE DORIA REPRENNENT POUR ELLE LA PLACE DE LA ROCHE-DERRIEN. -------------------
Après cette défaite, les Anglais restés en garnison à la Roche, se conduisirent à l'égard des habitants avec une excessive cruauté : «Ils en tuèrent un grand nombre», dit Dom Morice, «et ne réservèrent que ceux qu'ils crurent utiles à la culture des terres.» Les nobles du pays de Tréguier, indignés de ces odieux traitements, s'en plaignirent à Philippe de Valois et lui demandèrent des secours. Philippe leur envoya quelques troupes sous les ordres du Sire de Craon et d'Antoine Doria. Ce secours était insuffisant par lui-même, mais ces seigneurs armèrent à la hâte tous les hommes du pays, en état de porter les armes, et les conduisirent à la Roche-Derrien (1347). La place fut, pendant deux jours, attaquée et défendue avec beaucoup de courage. Le troisième jour, les Anglais offrirent de se rendre «Vie et bagues sauves», mais les assiégeants repoussèrent cette proposition et donnèrent un nouvel assaut qui dura jusqu'au lendemain sans résultat décisif. Le Sire de Craon craignant cependant que Thomas D'Ageworth ne vint une seconde fois au secours de la ville promit alors une somme de 5o écus à celui de ses soldats qui entrerait le premier dans la Place. Cette somme fut mise dans une bourse et placée au bout d'un bâton dépassant le mur, afin que tous pussent, la voir. L'appât du gain anima les guerriers, surtout les Génois qui faisaient partie des troupes de Philippe de Valois. Ces Génois se firent attacher aux murs, les sapèrent et y firent une brèche par laquelle l'armée entière pénétra dans la Place: Vieillards, femmes, enfants, tous ceux qui se trouvaient dans la ville furent passés au fil de l'épée. Deux cent cinquante Anglais, réfugiés dans le château, résistaient encore; ils se rendirent à la condition qu'on les conduirait sous bonne escorte à dix lieues de la Roche. Sylvestre de la Feuillée et un autre chevalier breton s'offrirent pour les accompagner et parvinrent, non sans peine, à les conduire à Châteauneuf de Quintin. Mais là des bouchers, des charpentiers et autres gens de métier, irrités contre ces Anglais qui avaient fait tant de mal dans notre pays, les enveloppèrent, et les tuèrent tous malgré les prières et les efforts des deux chevaliers bretons. La duchesse de Bretagne, Jeanne de Penthièvre donna le commandement de la Roche-Derrien à Antoine Doria qui lui avait rendu cette place et l'avait si bien servie dans la circonstance. . |
![]()
CHAPITRE VIII LE COMBAT DES TRENTE GEOFFROY DE LA ROCHE ----------------------
«de nombreux chefs de bandes des deux partis n'en parcouraient pas moins la province, rançonnant les villes et faisant des conquêtes pour leur propre compte. Dageworth avait péri non loin d'Auray, et ses compatriotes, pour venger sa mort, faisaient retomber leur colère sur les marchands et sur les laboureurs. Sir Richard Bemborough était le plus acharné d'entre eux. Les champs et les routes se couvraient de cadavres. Une foule d'enfants et de vieillards expiraient dans les cachots et les jeunes gens qui échappaient au massacre étaient menés sur les marchés où on en trafiquait comme de vils animaux. Les populations en proie à la faim, à la misère et à la maladie, maudissaient à la fois Édouard III, Jean de France (qui venait de succéder à Philippe de Valois) et Charles de Blois lui-même.»
L'Anglais irrité de la hardiesse d'un tel discours, lui dit d'une voix terrible : «Taisez-vous Beaumanoir, qu'il n'en soit plus question. Montfort sera duc de toute la Bretagne, Édouard sera couronné roi de France et les Anglais auront partout la puissance et le commandement.» (1). Beaumanoir répondit avec une grande modération : «Songiez un autre songe, cestuy est mal ce songié. Vos goberges Bemborough ne valent néant. Agissons plus sagement s'il vous plaist, délivrez les prisonniers et nous verrons après ce qu'il conviendra de faire.» Bemborough, refusant de mettre les paysans en liberté, s'emporta et finit par s'écrier : ---------------- (1) Tout le dialogue inséré dans ce chapitre est tiré de l'Histoire de Bretagne de Barthélémy. ---------------- «II ne faut pas s'imaginer qu'il existe au monde d'aussi vaillants guerriers que les Anglais; ils surpassent tous les autres en courage et en prouesses, et quant aux Bretons, qui donc en a parlé ? Qu'ont-ils fait ? Quelles conquêtes ont établi leur gloire ?...» Beaumanoir, en présence d'une telle forfanterie, eut peine à se contenir. Il répondit cependant avec une modération apparente et très méritoire : «Les Anglais sont sans doute des guerriers recommandables, mais, à mon avis, ils sont loin de l'emporter sur les Bretons. A l'occasion, je me fais fort de le leur apprendre par expérience; et si Bemborough dont j'estime le grand courage, ne veut pas attendre une rencontre fortuite, il n'a qu'à choisir le jour et le lieu, et là, sans plus de paroles, je le lui ferai reconnaître.» Et ce fut ainsi que fut décidé le combat des Trente (27 mars 1351). Dix chevaliers et vingt écuyers, tous Bretons, s'adjoignirent à Beaumanoir, qui n'eût que l'embarras du choix dans la noblesse bretonne, impatiente de se mesurer à l'ennemi. Bemborough eut grand peine à trouver ses trente soutiens; sa petite troupe se composait de vingt Anglais, six Allemands et quatre Bretons partisans de Montfort. On en vint aux mains. L'avantage fut d'abord du côté des Anglais qui tuèrent deux des Bretons et en blessèrent trois autres. Des deux côtés on s'attaquait et on se défendait avec acharnement. Le choix des armes avait été laissé au gré de chacun. Un Anglais combattait avec un maillet d'acier, du poids de 25 livres; un autre se servait d'une faux tranchante d'un côté, hérissée de crochets de fer de l'autre côté et dont les coups étaient mortels. La mêlée devint horrible et, après deux heures de lutte corps à corps, les adversaires, accablés de fatigue, s'arrêtèrent d'un commun accord pour reprendre haleine et se rafraîchir. Comme on allait reprendre le combat, Geoffroy de la Boche, qui assistait en spectateur au combat, s'écria : «Ah ! deux de nos amis ont déjà perdu la vie, trois autres sont prisonniers ! Dieu nous soit en aide ! Mais que ne suis-je chevalier ? Avec combien d'ardeur je ferais mes premières armes ! — Qu'à cela ne tienne, par sainte Marie ! dit Beaumanoir, beau doux fils, agenouille-toi. Je te fais chevalier. Souviens-toi de ton aïeul, Eude de la Roche, dont la valeur émerveilla tout l'Orient et songe que j'ai juré que les Anglais paieront ta chevalerie avant qu'il soit l'heure de complies.» Et ce fut ainsi qu'un seigneur de la Roche prit dans ce combat qui mit en relief la valeur bretonne, la place d'un de ceux qui y avaient laissé leur vie. . |
![]()
CHAPITRE IX JEAN DE MONTFORT ET CHARLES DE BLOIS SONT REMIS EN LIBERTÉ. MORT DE MONTFORT. SA FEMME REPREND LE COMMANDEMENT DES TROUPES QUI PASSERA APRÈS ELLE A SON FILS JEAN II DE MONTFORT. ----------------
Jean de Montfort avait été remis en liberté en 1342, après la trêve de Malestroit. Il reprit, la lutte, toujours soutenu par les Anglais, mais ce ne fut pas pour longtemps : il mourut trois ans après, en 1345. Sa femme, Jeanne de Flandres, comtesse de Montfort, ne fut pas plus frappée de sa mort qu'elle ne l'avait, été de sa captivité; elle reprit le commandement de ses troupes jusqu'au moment où épuisée par l'effort qu'elle avait fourni depuis le début de cette guerre, elle passa en Angleterre et, y perdit la raison. Son fils, Jean II de Montfort fil alors ses premières armes sous la direction de chefs anglais. Charles de Blois de son côté, après accommodement avec le roi d'Angleterre qui se décidait enfin à le reconnaître comme duc de Bretagne, fut, remis en liberté. Il rentra en France pour réunir la somme nécessaire au paiement de sa rançon et envoyer en Angleterre son fils aîné, Jean de Bretagne, le roi Édouard ayant posé comme condition à la libération du duc Charles, que Jean, son fils aîné, épouserait Marguerite d'Angleterre, sa propre fille, dont il voulait faire une duchesse de Bretagne. Entre temps, un seigneur anglais, le comte de Derby, fit observer au roi Édouard qu'il se déshonorerait, en abandonnant, par intérêt personnel, comme il allait le faire, la cause de son allié Montfort, pour embrasser celle de Charles de Blois. Il s'ensuivit que Jean de Bretagne, à son arrivée en Angleterre, non seulement n'épousa pas la princesse, mais qu'il fut fait prisonnier avec son frère Guy qui l'avait accompagné. La négociation se réduisit alors à traiter de la rançon de Charles de Blois, qui vint en Bretagne pour recueillir la somme nécessaire au recouvrement de sa liberté. Il l'obtint enfin, mais à condition que ses deux fils demeureraient en otage jusqu'au paiement intégral de sa rançon. Dans ce voyage qu'il fit en Bretagne, ce fut à la Roche-Derrien que revint Charles de Blois. Il profita du séjour qu'il y fit pour accomplir un pèlerinage à saint Yves. Ce fut, dit-on, pieds nus, par un jour de grand gel, qu'il fit le trajet de la Roche à Tréguier. Il y fut reçu par l'évêque Robert Peynel et son chapitre (1351). |
![]()
CHAPITRE X CHARLES DE BLOIS DEVENU LIBRE SE MET AU SERVICE DU ROI DE FRANCE, SON ALLIÉ. SIÈGE DE RENNES. DU6UESCLIN INTERVIENT; IL DEVIENT SEIGNEUR DE LA ROCHE-DERRIEN. ----------------
Mais au milieu des troubles et des désordres qu'amenait la guerre de cent ans, une nouvelle armée anglaise, sous les ordres du duc de Lancastre, cousin germain du roi Édouard, pénétra en Bretagne et vint mettre le siège devant la ville de Rennes. Le siège durait depuis neuf mois déjà et la ville, encerclée par les Anglais, ne pouvant recevoir de vivres, en était réduite à la plus affreuse disette. Lancastre qui le savait, usa d'un stratagème pour s'en emparer. Par son ordre un immense troupeau de porcs (2.000, dit-on) qu'il tenait en réserve pour le ravitaillement de son camp, fut poussé dans les prairies qui environnaient la ville de Rennes. Il pensait que la vue de ces animaux déterminerait les assiégés, pressés par la faim, à tenter une sortie pour s'en emparer, qu'il les battrait alors facilement et se rendrait maître de la ville. Mais à ce stratagème, le gouverneur de Rennes, Guillaume de Penhouët, dit le Tors ou le Boiteux, en opposa un autre. Par ses hommes, il fit prendre une truie qu'il suspendit par les quatre pattes à l'une des portes de la ville. On sait que les porcs accourent toujours du côté où ils entendent crier un de leurs congénères. Les cris poussés par la truie attirèrent de son côté le troupeau de Lancastre; le pont-levis fut abaissé, les pourceaux s'y engagèrent. La truie fut alors délivrée et poussée vers la ville, où elle attira à sa suite la plus grande partie du troupeau et Rennes se trouva ainsi ravitaillée pour quelque temps. Profitant de l'ouverture de cette porte, un des assiégés de Rennes était sorti de la ville. Il se rendit au camp de Lancastre et, se faisant passer pour un grand admirateur des Anglais et un grand ennemi de Charles de Blois, il donna au duc de faux renseignements sur la situation de la ville de Rennes. Traité avec amitié, laissé en liberté, cet homme en profita pour marcher dans la campagne en direction de Nantes. Il savait y rencontrer Duguesclin, qui errait avec ses compagnons entre cette ville et Rennes. Arrêté par ceux-ci, pris pour un espion, il n'eut pas de peine à se faire reconnaître pour ce qu'il était réellement, un ennemi des Anglais et un ardent partisan de Charles de Blois. Il mit Duguesclin au courant de la situation exacte de la ville de Rennes et lui apprit qu'il venait de rencontrer en chemin un énorme convoi de vivres qui se rendait, au camp de Lancastre. Marcher vers ce camp, l'attaquer à la faveur de la nuit, en bouleverser lentes les tentes, y mettre le feu, s'emparer du convoi de vivres et obliger les convoyeurs, sous la menace, à le conduire à Rennes fut un jeu pour Bertrand. L'affaire fut menée avec une telle vigueur, que les Anglais se crurent attaqués par 20.000 hommes. Or Duguesclin n'avait à ses côtés qu'une poignée de braves. Lorsque le convoi fut arrivé à Rennes, Bertrand se fît reconnaître : on lui ouvrit les portes, il fit entrer le convoi puis, en loyal chevalier, il paya largement aux convoyeurs le prix de leurs denrées et les renvoya avec leurs chevaux et leurs charrettes vides au camp de Lancastre avec ordre de lui dire : «Messire Bertrand vous salue et vous fait dire qu'il vous verra aussitôt qu'il le pourra, qu'il a tant de vivres pour lui et pour ses gens que, s'il vous plaît de vins a la ville, il vous en donnera tant que vous voudrez et de l'hypocras aussi pour adoucir votre cœur.» Le duc de Lancastre, loin de s'offenser de la hardiesse de Bertrand, manifesta le désir de le connaître. «Par saint Dunstan, lui dit le comte de Pembroke, c'est un gentil jeune homme. Monseigneur, et un vaillant chevalier, envoyez-lui un héraut avec un sauf-conduit, et Dieu me damne s'il ne vient pas vous voir !» Le sauf-conduit fut envoyé à Bertrand qui récompensa magnifiquement le héraut, sauta à cheval et se rendit au camp de Lancastre. Le duc l'accueillit avec politesse, lui fit force compliments, essaya de le détacher du parti de Blois, pour l'attacher à celui de Montfort, et le remercia d'être venu le voir, ainsi qu'il l'en avait prié. «Mais, lui
répondit Duguesclin, je serai toujours prêt à faire
tout ce que vous voudrez, hormis la paix, tant que vous
combattrez Monseigneur Charles de Blois qui est le seul
maître en Bretagne.» Cette boutade fit rire le duc. À ce moment survint Guillaume Bamboche, gentilhomme anglais dont Duguesclin avait tué le cousin au siège de Fongeray. Désireux de venger la mort de son parent, Bambrolle vint à Duguesclin et lui proposa un duel à «trois fers de glaive, trois fers de hache et trois coups de dague». C'était ce qu'on appelait alors le combat à outrance, combat qui ne devait se terminer que par la mort d'un des deux combattants. Duguesclin vint à l'Anglais, lui serra vigoureusement la main et lui dit : «Si trois fers de glaive, trois fers de hache et trois coups de dague ne te suffisent pas, je t'en offre six, et me donnerait-on ton pesant d'or que je ne renoncerais pas à ce combat !» La rencontre fut fixée au lendemain. En vain s'efforça-t-on dans l'entourage de Bertrand de le dissuader d'exposer inutilement sa vie. «J'ai donné ma parole, dit-il, je la tiendrai.» Le lendemain donc de grand matin, Duguesclin revêtit sa plus belle armure, omettant toutefois, dans sa folle témérité, de se garantir de sa cuirasse. Et ainsi accoutré, il alla entendre la messe dans l'église voisine et recommander son âme à Dieu. Comme il sortait de l'église, une de ses vieilles parentes qui l'aimait beaucoup, vint à lui et le supplia d'ôter son casque, afin qu'elle pût l'embrasser une dernière fois. Mais Bertrand, sautant sur son cheval, lui cria, en s'enfuyant au galop : «Ma tante, retournez dans votre maison, allez embrasser votre mari, et faites préparer le dîner : je serai de retour pour l'heure du bénédicité.» En effet, non seulement il vainquit Bambrolle et ne le tua pas, comme il en avait le droit dans cette sorte de combat, mais il ne le fil pas même prisonnier; il se contenta de prendre son cheval qu'il donna au héraut de Lancastre, et, à l'heure dite, Bertrand arriva tout joyeux chez sa tante pour se mettre à table et manger d'un fort bel appétit. L'entrevue de Lancastre et de Duguesclin n'avait modifié en rien la situation de Rennes. Le siège, bien qu'une trêve eût été conclue antérieurement durait toujours et ceci parce que le duc de Lancastre s'était juré sur les Évangiles, de ne quitter cette ville avant d'y avoir fait flotter le drapeau anglais. Les vivres procurés par Duguesclin étaient épuisés; la famine se faisait de nouveau cruellement sentir et Bertrand, qui n'avait aucun moyen de ravitailler Rennes une seconde fois, voyait avec angoisse qu'il allait falloir se rendre. Le Pape, ayant appris par son légat, qu'au mépris de la trêve le siège durait toujours, écrivit au roi d'Angleterre pour lui en faire le reproche, Édouard donna aussitôt au duc de Lancastre l'ordre de lever le siège. Terrible perplexité pour le duc; il se voyait dans l'alternative de désobéir à son roi ou d'être infidèle à son serment. Duguesclin, qui le savait, lui fit dire que s'il consentait à venir à Rennes avec une escorte de dix hommes seulement, et s'il s'engageait par serment à en lever ensuite le siège, on lui en ouvrirait les portes et lui permettrait d'y planter son drapeau. Ravi d'une offre inespérée, qui lui permettait de concilier honorablement l'obéissance due au roi et son propre serment, Lancastre s'empressa de l'accepter. Duguesclin donna aussitôt l'ordre à tous tons les bouchers, charcutiers et marchands de comestibles de la ville, de réunir tout ce qui y restait de victuailles et d'en faire un large étalage dans la rue que devait parcourir le duc, afin qu'il ne sût pas que la ville était réduite à une extrême disette et à la veille de se rendre. Au jour fixé, Lancastre vint; on lui offrit un vin d'honneur et on le conduisit sur les remparts, où il planta fièrement son drapeau au-dessus de la porte qui donnait du côté de son camp. Mais à peine fut-il sorti de la ville, que ce drapeau fut arraché, foulé aux pieds, souillé de boue et mis en lambeaux. Furieux, mais lié par l'ordre du roi et par le serment fait de quitter Rennes, après y avoir vu flotter le drapeau anglais, Lancastre leva le siège et se retira à Auray, avec son allié Montfort. Et, une question se pose ici tout naturellement : «Qu'est venu faire ce siège de Rennes dans l'histoire de la Roche-Derrien ?» II a avec elle un corrélation très étroite, car ce fut pour avoir ravitaillé Rennes, lui avoir permis de tenir si longtemps et en avoir ensuite fait lever le siège, que Duguesclin reçut de Charles de Blois, en récompense de ses services, la seigneurie de la Roche-Derrien, avec le titre de vicomte de cette ville et que nous eûmes l'honneur de le compter au nombre de. nos concitoyens.
Du Guesclin |
![]()
CHAPITRE XI BATAILLE D'AURAY. — MORT DE CHARLES DE BLOIS. JEAN II DE MONTFORT DEVIENT DUC DE BRETAGNE SOUS LE NOM DE JEAN IV. IL TRAITE AVEC JEANNE DE PENTHIËVRE. -------------------
Après divers faits d'armes que nous passerons sous silence, puisqu'ils n'intéressent pas !a Roche-Derrien, elle se termina, le 3o septembre 1364, par la grande bataille d'Auray, qui se livra dans les landes sur lesquelles s'élève aujourd'hui la Chartreuse. Dirigé par Jean Chandos, célèbre capitaine anglais, Montfort, encore jeune et inexpérimenté, était venu assiéger le château d'Auray. Charles de Blois, qui se trouvait alors à Nantes, en sortit avec ses troupes pour venir le combattre; il était appuyé par le roi de France, Charles V, qui donna ordre à Duguesclin de se rendre en Bretagne avec mille lances pour soutenir sa cause. La bataille fut rude. Montfort se battit avec beaucoup de courage à côté de Chandos qui, tout en portant des coups terribles lui criait : «Faites ceci, allez-la, venez de ce côté»; injonctions auxquelles le jeune prétendant s'empressait d'obéir. Charles de Blois, par sa valeur et par celle de ses troupes, avait jusqu'alors remporté l'avantage et il semblait que la victoire dût lui rester. Il avait poussé si vivement le comte de Montfort qu'il avait renversé sa bannière. Mais à ce moment survint Caverley, qui commandait l'arrière-garde de l'armée adverse; ce capitaine anglais vint le prendre de dos, mit le désordre dans ses troupes, abattit son drapeau et le fit prisonnier. Un soldat, aussitôt après, lui perça la gorge et le tua. Ce fut, croit-on, un assassinat, commis par ordre de Montfort peut-être. Duguesclin qui pendant toute la mêlée avait frappé avec furie, apprenant le sort de Charles, et voyant que tout pliait devant l'ennemi, se battit en désespéré pour vendre chèrement sa vie; mais épuisé de fatigue, blessé et ayant perdu ses armes, il se rendit à Chandos et fut prisonnier. Maître du champ de bataille, Montfort, le vainqueur de la journée, devint duc de Bretagne sous le nom de Jean IV. Après cette bataille d'Auray qui le mit en possession du duché de Bretagne, Montfort se montra disposé à traiter avec Jeanne de Blois, à la condition qu'elle le reconnaîtrait comme seul duc de Bretagne. La province était épuisée, bon nombre de seigneurs, de lassitude se rangeaient déjà du côté de Montfort : Jeanne dut traiter. Le nouveau duc la remit alors en possession de la vicomte de Limoges, qui avait été la dot de sa grand'mère et de toutes ses terres du Penthièvre, y compris la seigneurie et la place de la Roche-Derrien dont elle jouit jusqu'à sa mort qui survint le 10 septembre 1381. Elle fut enterrée aux Cordeliers de Guingamp. La vieille duchesse n'avait pas eu, avant d'expirer, la joie de revoir ses deux fils aînés, que la politique anglaise retenait prisonniers, depuis le jour où leur père les avait livrés en otages, pour se racheter lui-même, après le combat de la Roche-Derrien. |
![]()
CHAPITRE XII MONTFORT PERSÉCUTE CLISSON QUI SE SÉPARE DE LUI POUR S'ALLIER AUX PENTHIÈVRE. -LEUR LUTTE, LEUR HAINE. LA ROCHE-DERRIEN EN SUIT LES FLUCTUATIONS, ELLE EST REMISE A JEAN DE MONTFORT ET PLUS TARD LUI EST REPRISE POUR ÊTRE MISE EN SÉQUESTRE ENTRE LES MAINS DU ROI. ----------------
Jean IV, par le traité de Guérande, signé le 13 avril 1365, après la bataille d'Auray, s'était engagé à remettre en liberté les fils de Charles de Blois, toujours prisonniers en Angleterre, et Clisson le pressait de remplir celte clause du traité; mais le duc, dont la bonne foi n'était pas la qualité maîtresse, prétendait qu'il n'était pas obligé de payer leur rançon, mais seulement "de leur rendre de bons offices pour qu'ils devinssent libres». La mort de Guy, le plus jeune des deux frères, étant survenue, Clisson forma l'ambitieux projet de marier sa fille au prince Jean, resté seul et qui devenait devenir duc de Bretagne si Jean IV, qui n'avait pas eu d'enfant de ses deux premières femmes, devait rester encore sans héritier. Ce mariage disproportionné, auquel la vieille duchesse, Jeanne de Penthièvre, n'aurait jamais consenti, Clisson le proposa à Jean de Bretagne qui, las de sa longue captivité, l'accepta contre l'offre que lui fit le connétable de payer sa rançon. Le duc de Bretagne, Jean de Montfort, fut très offensé de cette démarche de Clisson, avec qui il avait déjà eu de nombreux dissentiments, et, dès ce jour, il lui voua une haine mortelle. Sous de faux semblants d'amitié, le faisant venir à Vannes, Jean IV, affectant d'avoir son avis sur la construction du château de l'Hermine, l'y conduisit, le fit saisir, enchaîner, retenir prisonnier et donna l'ordre de le mettre à mort dans la nuit même. En vain le sire de Laval, beau-frère de Clisson, et le maréchal de Beaumanoir reprochèrent-ils au duc sa conduite, le suppliant de rendre la liberté au prisonnier. Bazvalan le gouverneur du château, qui avait été chargé de l'exécution, vint lui-même se jeter aux pieds du duc le conjurant d'abandonner son projet et lui représentant les conséquences terribles d'un tel traitement exercé sur le premier officier de la couronne de France, sur un homme si haut placé par ses exploits, ses richesses et ses alliances. Le duc fut inflexible. Voyant qu'il n'y avait rien de bon à attendre de ce prince en délire, Bazvalan résolut de surseoir à l'exécution et de gagner du temps. Il fut trouver le sire de Laval et le supplia de renouveler les instances qu'il avait déjà faites pour obtenir la grâce du prisonnier. Jean IV ne voulut encore rien entendre. A la réflexion, cependant, il comprit que l'indignation générale risquait de lui faire perdre sa couronne. Le lendemain, de grand matin, il fit appeler Bazvalan pour lui donner contre-ordre. Bazvalan parut affectant une contenance morne et le duc lui ayant demandé s'il avait exécuté ses ordres ? «Monseigneur, répondit Bazvalan, vous me le commandâtes en telle instance, que je n'eusse osé y faillir : c'est fait !» (1). A ces mots Montfort laissa éclater ses sanglots : «Hé Dieu ! s'écria-t-il, que m'est-il advenu ?... Que ferai-je ? Que fera mon pauvre pays que je vois déjà allumé en guerre, mes ennemis ... (1) Ce dialogue m'est fourni par l'Histoire de Barthélémy. ---------------- «... par les villes, et moi banni, exilé, en fuite en Angleterre ?... Clisson est-il bien mort, demanda-t-il, une seconde fois ? - - Oui, Monseigneur, répondit Bazvalan, soudain que j'ai entendu la mynuict, je l'ay fait mettre au sac et l'ayant tenu dans l'eaüe et noyé, je l'ai fait lever, afin que le corps ne fût trouvé et l'ay fait enterrer auprès du chasteau.» A ces mots, le désespoir de Montfort fut terrible. Il maudissait sa colère : «Pleust à Dieu, Bazvalan, que je vous eusse creu ! Je vois bien que je serai tout le reste de ma vie en pauvreté et en mendicité et pleust à Dieu que je fusse le plus pauvre gentilhomme de ce duché et en seureté de ma personne.» Bazvalan, à qui le duc avait intimé l'ordre de ne plus reparaître devant lui, se retira, le laissant à ses regrets : il voulait que l'épreuve fut complète. Il épia le duc au cours de la journée et quand il fut bien assuré de son désespoir, il reparut devant lui et lui avoua sa désobéissance. Passant alors de l'excès du désespoir à celui de la joie Jean V se jeta au cou de Bazvalan, l'embrassa à plusieurs reprises et lui promit de le récompenser du service qu'il lui avait rendu. Mais, comme l'avait pressenti Bazvalan, la crainte de perdre sa couronne, plus qu'un repentir réel, avait déterminé Jean IV : il ne consentit à relâcher son prisonnier qu'à beaux deniers comptant. La rançon de Clisson fut fixée à 100.000 livres et il lui fallut accepter un traité, signé le 27 juin 1887, stipulant que ses villes et forteresses, ainsi que celles de Jean de Penthièvre, son gendre, c'est-à-dire, Clisson, Josselin, Lamballe, Broons, Jugon, Blain, Guingamp, La Roche-Derrien, Châtelaudren et Chateaugui, près Oudon, seraient remises au duc dans les trois jours suivants. La Roche-Derrien fut remise le 30 juin à Geoffroy de Kermalec, qui en prenait possession au nom du duc Jean IV. Et le sort de votre ville sera désormais lié et subordonné aux phases diverses de la lutte entre Clisson et Mont fort. Comme on le pense bien, Olivier de Clisson n'aspirait qu'à déchirer un traité si onéreux et si déloyalement extorqué. Il se rendit à Paris pour demander justice. Charles VI aimait Clisson et était courroucé d'un attentat qui avait causé une indignation universelle; il promit de mesurer la punition à l'énormité du crime. La peine, c'étaient les pairs qui devaient la prononcer. Montfort, convoqué à Paris, n'y vint pas. Il déclara que, si un acte de violence avait été commis, ce n'était pas au mépris de l'autorité royale, ni contre un connétable de France, mais contre un vassal et sujet du duché de Bretagne, et qu'il avait usé de son droit de justice et de souveraineté contre Clisson avec plus d'indulgence qu'il ne le méritait. Charles VI se contenta de cette explication, mais il n'en fut pas de même de Clisson qui prit les armes pour se faire justice lui-même. Il passa en Bretagne où quelques seigneurs l'aidèrent à reprendre quelques-unes des places que Jean IV lui avait extorquées. Charles VI contrarié d'un état de choses qui suspendait l'exécution de ses projets contre l'Angleterre intima aux deux parties l'ordre de cesser les hostilités et de se soumettre à son arbitrage, ce que Montfort accepta, mais après avoir préalablement déclaré dans son conseil (19 et 31 décembre 1387), qu'il protestait d'avance et, ne se dessaisirait d'aucune des places cédées par Clisson. Cite à comparaître devant le roi à Orléans, Jean IV ne se présenta ni en personne ni par un procurateur. Il ne vint même plus tard à Paris que pressé par son Conseil. Charles VI prononça son jugement le 20 juillet 1388 à l'hôtel Saint-Paul. Il fut convenu que le duc rendrait à Clisson : Josselin, Blain, Broons, Le Gavre, Gaillac et leurs dépendances. Quant aux seigneuries de la Roche-Derrien, de Guingamp, de Lamballe et de Châtelaudren, elles furent mises en séquestre entre les mains du roi qui devait les rendre à qui elles devaient appartenir et la paix fut une fois encore rétablie entre les irréconciliables ennemis. |
![]()
CHAPITRE XIII SUITE DE LA LUTTE ENTRE CLISSON ET MONTFORT; CELUI-CI ENVOIE REPRENDRE LA ROCHE-DERRIEN. CHARLES VI INTERVIENT ET OBLIGE LE DUC A RENDRE CETTE PLACE A JEAN DE PENTHIEVRE. --------------------
Thomas de Kerrien, qui commandait la place de la Roche-Derrien, refusa de la remettre au Duc. La raison qu'il donna de son refus, et dont Jean IV se contenta, fut que ni lui ni ses compagnons n'oseraient sortir du château craignant la violence du comte Jean de Penthièvre, gendre de Clisson et les hommes de son parti. La raison parut si plausible au duc, tant était redouté le comte de Penthièvre de ceux qui servaient la cause de ses ennemis, qu'il consentit que Kerrien demeurât dans la place en prêtant un nouveau serment. Lorsque Charles VI revint à Paris, les démêlés de Jean IV et du connétable étaient plus animés que jamais. On était alors à la fin de 1390. L'année suivants se passa en escarmouches et en négociations. Les amis communs des deux antagonistes parvinrent à les rapprocher. Il en résulta un arrangement qui, s'il fut consenti, ne fut pas exécuté. Charles VI désirait cependant qu'un accommodement entre les deux ennemis ôtât à Montfort tout prétexte de s'allier aux Anglais à l'expiration de la trêve conclue avec cette nation le 18 juin 1389. Il s'y employa de façon à amener le traité de Tours, du 26 janvier 1892. Ce traité stipulait que le duc de Bretagne paierait à Clisson ce qu'il restait lui devoir des 100.000 livres de rançon qui lui avaient été arrachées; que la Roche-Derrien serait rendue au comte Jean de Penthièvre, comme étant son propre héritage, ainsi que les autres terres qu'il possédait en Bretagne. Le duc s'engageait à rendre la Roche-Derrien dans les 20 jours et pour en assurer davantage le comte de Penthièvre, Charles de Dinan, comte de Chateaubriand, le sire de Malestroit et le sire de Quintin, chevaliers, durent, au sortir de Tours, se rendre en otages au château d'Angers, d'où ils ne devaient sortir que lorsque ces places auraient été délivrées à Jean de Bretagne. II fut stipulé aussi que les excès seraient réciproquement pardonnés, les sentences annulées, les procédures anéanties. Tout ce qui ne consistait qu'en paroles fut exécuté sur-le-champ. Il en fut tout autrement des stipulations qui devaient se traduire en actes. Le traité de Tours resta lettre morte; il fit cesser la guerre ouverte, sans atténuer les haines qui couvaient aussi intenses qu'auparavant.» |
![]()
CHAPITRE XIV LA HAINE DE CLISSON ET DE JEAN IV ATTEINT SON PAROXYSME. PIERRE DE CRAON ATTENTE AUX JOURS DE CLISSON. FOLIE DE CHARLES VI. JEAN III MET LE SIÈGE DEVANT LA ROCHE-DERRIEN QUI SE REND : LA PLACE ET LES FORTIFICATIONS SONT RASÉES. ----------------------
Pierre de Craon, sénéchal et premier baron de l'Anjou, avait été longtemps protégé par le duc d'Orléans. Ses débauches et sa conduite le firent enfin chasser de la cour, sur la demande même de son protecteur. Il attribua sa disgrâce à Clisson qu'il savait avoir de l'influence sur le duc d'Orléans. Furieux, il se rendit à la cour de Bretagne et après s'être concerté avec Montfort, sur les moyens de se débarrasser de leur ennemi commun, il dirigea à plusieurs reprises sur Paris "de mauvais garçons", bien armés et résolus à tout entreprendre. Le 14 juin 1392, Charles VI tint cour plénière à «l'Hôtel des grands ébastements» (l'Hôtel Saint-Paul) et y donna une fête qui se prolongea fort avant dans la nuit. Clisson en sortit vers une heure du matin, se rendant à cheval à son hôtel, n'ayant pour escorte que huit hommes sans armes, quand lui et ses gens furent brusquement assaillis par une troupe à cheval qui arracha le flambeau que l'on portait devant lui. Clisson crut d'abord à une plaisanterie du duc d'Orléans dont il connaissait l'humeur joyeuse. Mais Pierre de Craon, tirant son épée, lui cria : «A mort 1 A mort Clisson ! cy vous faut mourir. — «Et qui es-tu, répondit Clisson, d'une voix terrible, qui es-tu qui oses dire de ce telles paroles ? — Je suis Pierre de Craon, votre ennemi, vous m'avez tant courroucé, qu'icy vous le faut amender». «En avant !» dit-il à ses gens. Et aussitôt tous se précipitèrent sur le connétable. Clisson, qui n'avait pour toute arme qu'une dague, lutta énergiquement contre ces nombreux assassins, jusqu'au moment où un violent coup, asséné sur sa tête, le renversa de son cheval et le fit rouler dans la boutique d'un boulanger qui venait d'ouvrir sa porte, au bruit. Les assassins le croyant mort, s'empressèrent de prendre la fuite. Informé immédiatement de l'attentat, le roi, Charles VI, donna l'ordre de se mettre à la poursuite de Pierre de Craon et se rendit près de Clisson. Pierre de Craon, qui avait gagné son château de Sablé, y apprit avec effroi que Clisson vivait encore. Redoutant la colère du roi, il alla chercher refuge auprès de Montfort, qui l'accueillit fort mal : "Vous êtes un chestif, lui dit-il, quand vous n'avez sçu occire un homme duquel vous étiez au dessus.» A quoi Pierre de Craon, qui regrettait tant lui-même d'avoir manqué son coup, répondit : «Monseigneur, c'est, bien diabolique chose; je crois que tous les diables de l'enfer, à qui il est, l'ont gardé et délivré de mes mains, car il y eut sur lui lancé et jeté plus de soixante coups que d'épées et de grands couteaux.» Quand le roi apprit que le duc de Bretagne donnait asile à Craon, il demanda que le meurtrier lui fut livré. Montfort refusa. Alors Charles VI, irrité de la désobéissance de son vassal, marcha contre la Bretagne avec son armée. Il traversait la forêt du Mans lorsqu'il fut atteint du terrible accès de folie qui devait priver la France du meilleur de ses rois (1). Perdant l'appui de Charles VI, et sachant que les ducs de Berry et de Bourgogne lui étaient hostiles, Clisson partit pour la Bretagne. Persécuté en France et condamné au bannissement, il fut aussi attaqué en Bretagne par Montfort qui, ... (1) Cette marche de Charles VI sur la Bretagne est liée à l'Histoire de la Roche et l'intéresse particulièrement puisqu'elle fut entreprise pour venger Clisson, beau-père et père de ceux qui en étaient les seigneurs. --------------- ... dans la situation où il le voyait, pensait en avoir facilement raison. Clisson lui opposa une résistance à laquelle il ne s'attendait pas : mettant sur pied des troupes de France, qu'à l'insu des ducs de Berry et de Bourgogne lui envoyait le duc d'Orléans, Clisson alla s'enfermer à Josselin. Poussé par Pierre de Craon, Montfort, vint l'y assiéger. Mais Clisson, averti par le comte de Royan y laissa une bonne garnison et en sortit secrètement pour aller s'enfermer à Moncontour. Le duc, le croyant à Josselin, vint en faire le siège dans les formes. Réduits à l'extrémité, les assiégés firent prévenir le connétable, et celui-ci n'ayant pas assez de troupes pour contraindre le duc à lever le siège, prit le parti de la négociation. Montfort se rendit ensuite au château de la Chèze, où Clisson devait le rejoindre pour ratifier le traité; il n'y vint pas, alléguant que le duc avait près de lui Pierre de Craon. Montfort en fut très irrité et se prépara à lui faire la guerre l'année suivante. Cependant, Charles VI, qui avait des intervalles de raison, fort mécontent de l'arrêt de bannissement que les ducs de Berry et de Bourgogne avaient fait rendre contre Clisson, fit révoquer cet arrêt. Venu au Mont Saint-Michel pour accomplir un vœu, le roi, sur l'avis de son Conseil, profita de cette proximité de la Bretagne pour y envoyer des ambassadeurs et tâcher, une fois encore, de rétablir la paix entre Montfort cl Clisson. Le duc, après leur avoir d'abord refusé le sauf-conduit, se décida à les recevoir, leur fit des promesses et leur donna des assurances de paix qu'il ne tint pas. Les actes d'hostilité recommencèrent et le duc vint mettre le siège devant La Roche-Derrien. Roland II de Coëtmen, vicomte de Tonquédec, qui commandait cette place, ne se sentant pas de force à lutter contre l'armée du duc, prit le parti de venir tête nue, le chaperon à la main, se jeter à ses pieds pour obtenir son pardon et promettre de lui être désormais fidèle. Il était accompagné des principaux officiers de sa garnison. Jean IV leur pardonna, il réserva ses rigueurs à cinq ou six des plus coupables qu'il envoya prisonniers au château de l'Hermine. Mais pour se venger de Clisson et des Penthièvre, Jean IV fit raser les fortifications de la place et du château de la Roche-Derrien, en présence des ambassadeurs de France qui étaient accourus et !e suppliaient d'en user avec plus de modération (1394). Ainsi donc la ruine de notre ville fui la conséquence de cette longue lutte entre les maisons de Blois et de Montfort, entre Clisson et Jean IV. Clisson se vengea de la destruction de la Roche-Derrien en allant attaquer Saint-Brieuc, qu'il prit en quinze jours; puis il marcha vers le château du Périer, dont il se rendit maître en huit jours et qu'il fit démolir comme le duc avait fait abattre celui de la Roche-Derrien. Charles VI chargea le duc de Bourgogne de pacifier la Bretagne et de mettre fin aux différends du duc et de Clisson. Celui-ci, entre autres griefs, parlant en son nom et au nom de son gendre, reprochait à Jean IV d'avoir pris et rasé la Roche-Derrien. Montfort répondit que contre le traité d'apanage de Penthièvre, entre lui et Guy de Bretagne, ça comté avait établi des droits de traite et d'entrée sur le port de la Roche-Derrien et de plus que Clisson et lui en avaient fortifié l'église, ainsi que celle de Brélévenez. Le comte et Clisson répondirent que c'était par ordre du roi (1394) et que, sur cet article du temporel de l'église, ils avaient fortifié celle de la Roche-Derrien pour «tenir lieu du chasteau qui avait été rasé». |
![]()
CHAPITRE XV LE ROI DE FRANCE PRIE JEAN IV DE NE PLUS FAIRE LA GUERRE AU CONNÉTABLE. RÉCONCILIATION DES DEUX ENNEMIS. ----------------
Cette exorbitante demande fut rapportée au duc qui ordonna de continuer la guerre. Mais il apprit alors que le roi d'Angleterre sollicitait à la cour de France la main de la fille aînée de Charles VI, promise à son fils par un traité solennel. Il réfléchit qu'il était vieux et ses enfants très jeunes; que, de plus, la majorité de ses barons favorisait secrètement ou ouvertement le parti de Clisson et du comte de Penthièvre. Il craignit que s'il mourait sans avoir établi une paix solide, ses enfants ne courussent le risque de ne jamais lui succéder. Le peuple gémissait d'ailleurs des désordres d'une longue guerre. Ces motifs portèrent le duc à faire lui-même des avances pour obtenir la paix. A cet effet et sans en référer à son Conseil, il dicta à son secrétaire une lettre pleine de courtoisie et, d'amitié pour Clisson, à qui il demandait un entretien particulier. Cette lettre fut portée à Josselin par un homme discret et sûr. Clisson fut surpris de sa réception et la lut plusieurs fois, ayant peine à croire qu'elle fut de Montfort, mais le cachet du duc ne laissait nulle place au doute. Il répondit donc qu'il était disposé à l'aller trouver, mais qu'il le priait, pour l'y engager, de lui donner pour sûreté son fils aîné en otage. La condition était dure, mais le duc, cette fois, ne la refusa pas. Le jeune prince avait à peine six ans (1); il ... (1) Jean IV n'avait pas eu d'enfant de ses deux premières femmes, il n'en eut que de la troisième et lorsqu'il était déjà avancé en âge. ------------------- Touché de cette marque de confiance et d'estime, le Connétable résolut aussitôt d'aller trouver le duc et de lui ramener son fils. Jean IV fut très sensible à son tour à la générosité de Clisson; ils eurent ensemble un long entretien et un traité de paix, dicté par la bonne foi, fut enfin conclu et fidèlement exécuté. |
![]()
CHAPITRE XVI LES FORTIFICATIONS DE LA ROCHE-DERRIEN SONT RÉTABLIES. UNE TRAHISON DES PENTHIÈVRE LES FAIT RASER DE NOUVEAU ET CETTE FOIS DÉFINITIVEMENT. ----------------- La longue querelle de Montfort et de Clisson avait, comme nous l'avons vu, amené la destruction des fortifications et du château de la Roche-Derrien; leur réconciliation permit de les reconstruire et notre ville, relevée de ses ruines, reprit son ancienne grandeur. Hélas ! ce ne fut pas pour longtemps : une trahison des Penthièvre devait, quelques années plus tard, les faire raser de nouveau et cette seconde fois pour toujours. Voici les faits : Si Jeanne de Penthièvre, comtesse de Blois, s'était résignée, après la bataille d'Auray, à la perte de sa couronne, Marguerite de Clisson, sa belle-fille, femme ambitieuse et cruelle (1), ne ... (1) Jean de Bretagne était mort, laissant Marguerite veuve avec ses quatre fils. Il n'avait survécu que de quelques années à sa mère et fut enterré, comme elle, aux Cordeliers de Guingamp. ---------------- ... rêvait que de placer ses enfants sur le trône ducal de Bretagne. Jean IV mourut à Nantes dans la nuit du Ier au 2 novembre 1899, après avoir confié par testament la tutelle de ses enfants an duc de Bourgogne, son plus proche parent, en lui adjoignant Clisson. La nouvelle en arriva au château de Josselin, où se trouvait alors la comtesse de Penthièvre, Marguerite de Clisson. Le duc de Bourgogne, qui était à la cour de France, n'était pas encore arrivé et les enfants du duc défunt allaient être remis à Clisson. Alors Marguerite accourut à la chambre de son père et lui tint ce langage : «Monseigneur mon père, il ne tient qu'à vous de remettre mes enfants en possession de l'héritage de leur père, je vous supplie que vous nous y aidiez. «— Et par quel moyen se pourrait-il faire ?» dit le vieux chevalier que la tentation effleura un moment. — «Vous tenez entre vos mains les enfants de ce duc qui nous a fait tant de mal, ne pourriez-vous les faire mourir secrètement ?» A ces mots, tout l'honneur du vieux Clisson se réveilla : «Ah ! femme cruelle et perverse, s'écria-t-il, tu seras la cause de la mine de tes enfants, tu leur feras perdre à la fois et leurs biens et l'honneur !» Et, dans son indignation, saisissant une pertuisanne qui se trouvait à sa portée, il eût tué sa fille, si celle-ci, fuyant sa colère, n'eût si précipitamment descendu l'escalier, qu'elle y fît une chute et se brisa une jambe. Elle en demeura boiteuse toute sa vie et ce fut un nouveau grief contre les Montfort. Marguerite ayant si mal réussi du côté de son père, tourna plus tard ses vues du côté de ses fils qui étaient à la cour du nouveau duc, Jean V, et traités par lui avec beaucoup d'amitié. Jean V avait même fait de Charles, l'un d'eux, son premier chambellan et le Maréchal de sa noblesse. Circonvenus par leur mère, Charles et Olivier de Clisson vinrent trouver le duc et affectant de vouloir s'unir plus étroitement à lui par des liens de chevalerie, comme il s'en faisait à cette époque, ils l'invitèrent à se rendre à Champtoceaux, forteresse qu'habitait Marguerite, où leur mère, disaient-ils, préparait en son honneur, de belles fêtes, de grandes chasses et de joyeux festins. Le Conseil du duc voyait avec appréhension ce voyage; mais Olivier de Penthièvre se montra si pressant qu'il persuada Jean. Le jeune duc envoya devant lui ses maîtres d'hôtel, plusieurs de ses chambellans et d'autres officiers, avec sa vaisselle d'or et d'argent, puis il se mit lui-même en route avec son frère Richard, suivi de son escorte et de celle des Penthièvre. Tout alla bien jusqu'au passage de la rivière La Divette. Mais là, l'escorte des Penthièvre, affectant de folâtrer, retint l'escorte du duc et laissa celui-ci passer outre avec son frère Richard. A peine furent-ils engagés sur l'étroit pont de bois qui devait les mener à l'autre rive, qu'en arrachant les planches derrière eux et les jetant à l'eau, ils s'opposèrent au passage de l'escorte du duc. Jean V qui avait d'abord cru à un jeu et qui s'en était amusé, cessa bientôt de rire, quand il vit accourir vers lui, sortant d'un bois voisin, Olivier de Clisson, escorté de 4o lances. Olivier mit la main sur le duc de Bretagne; «Nous te tenons enfin ! s'écria-t-il, et avant de nous échapper, tu nous auras rendu notre héritage.» Jean V, ainsi pris traîtreusement, fut garotté sur son cheval et emmené, tandis que «deux grands ribauds» chevauchaient à ses côtés avec ordre de le tuer au moindre signe de résistance. En cours de route, Olivier de Penthièvre s'arrêta chez des amis, pour boire, manger et «se galer», comme on disait à cette époque. Pendant ce temps, l'infortuné duc, toujours lié sur son cheval, était laissé à la porte, grelottant de froid sous une pluie battante; on était en février. L'arrivée à Champtoceaux n'eut lieu que le lendemain. Marguerite commença par faire main basse sur la vaisselle d'or et, d'argent du duc, puis elle vint à lui, lui fit de véhéments reproches, réclama impérieusement la couronne de Bretagne pour ses enfants, l'engagea à prendre son mal en patience et se retira après lui avoir récité le verset : «Deposuit potentes de sede». Jean V et son frère furent enfermés dans une pièce dont on avait bouché toutes les issues et garni les fenêtres pour qu'ils ne pussent voir ce qui se passait au dehors. Pendant leur captivité, il n'est pas de violences, d'avanies, d'injures, de menaces de mort qu'ils ne subirent; et, afin de faire perdre leur trace à ceux qui auraient voulu les secourir, on les menait prisonniers de château en château. Dans ces voyages forcés, les deux princes étaient traités avec une cruauté sans exemple : un carcan, passé à leur cou, soutenait une chaîne qui liait leurs bras et leurs jambes. La duchesse de Bretagne, Jeanne de France, fille de Charles VI, apprenant la captivité de son mari, réunit les États, fit appel à ses barons et les pressa de voler au secours de leur souverain. Les seigneurs bretons, refusant avec une générosité sans exemple, les bagues et les joyaux de grand prix que la duchesse voulait leur remettre pour couvrir les frais de l'expédition, s'équipèrent à leurs frais, réunirent 50.000 hommes, qui furent passés en revue par Raoul de Coëtquen, maréchal de Bretagne, le 22 juin 1420, et dirigèrent celte armée sur Champtoceaux, non sans s'arrêter au passage pour prendre les places fortes qui appartenaient aux Penthièvre. Ils s'emparèrent ainsi de Jugon, de Lamballe. de Guingamp, de la Roche-Derrien, de Châteaulin-sur-Trieux et vinrent enfin mettre le siège devant Champtoceaux, forteresse assise comme un nid d'aigle sur une roche escarpée, et réputée jusque-là imprenable. Elle fut tellement battue cependant par l'artillerie que les murs en furent bientôt ébranlés. Des renforts considérables furent amenés aux assiégeants par l'écuyer Raoul de la Roche et les assiégés commencèrent à craindre d'être forcés. La vieille comtesse Marguerite s'était signalée par son courage au cours de ce siège, mais elle dut bientôt se réfugier dans les caves avec ses deux plus jeunes fils (Olivier et Charles, les grands coupables, avaient fui) et il lui fallut enfin se rendre. Le plus jeune de ses fils, Guillaume, fut livré en otage. Les vainqueurs posèrent comme condition que Marguerite et ses fils feraient réparation au prince et, comparaîtraient à cet effet devant le grand Parlement de Bretagne, au jour qui lui serait fixé, moyennant quoi on lui laisserait la libre disposition de ses biens et on lui rendrait son fils. Marguerite promit de s'y rendre, mais cette femme, qui n'avait jamais rien pardonné à personne, ne crut pas à tant de générosité de la part du duc. Au jour fixé, ni elle ni ses fils ne comparurent : seul, le jeune Guillaume était présent. Pour punir Marguerite de cette nouvelle félonie, on rasa Champtoceaux, on confisqua tous ses biens. Le jeune Guillaume, d'otage qu'il avait été jusque-là devint prisonnier; il le demeura toute sa vie et perdit la vue à force de pleurer. Le Parlement, se réunissant à nouveau, déclara les Penthièvre «atteints et convaincus de félonie, de trahison, de lèse-majesté, déchus de fiefs et de foi, les condamna à la peine capitale, à la a privation perpétuelle des noms et armes de Bretagne, comme infâmes et déloyaux et intima l'ordre à tous les sujets du duc de les appréhender au corps, si le cas y échéait ". Ainsi se trouvèrent réalisées les prévisions du vieux Clisson. Marguerite avait fait perdre à la fois à ses fils et leurs biens et l'honneur. Les fortifications de Lamballe, de Jugon, de Broons, d'Avaugour, de Châtelaudren, de Guingamp, de la Roche-Derrien et d'un grand nombre d'autres places qui avaient appartenu aux Penthièvre furent rasées. Une armée, envoyée en Poitou où ils s'étaient réfugiés, prit leurs châteaux de Sainte-Hermine, de Palau, du Coudray, des Essarts, etc., etc. Les terres immenses de la maison de Penthièvre servirent à récompenser les seigneurs qui avaient combattu pour la délivrance de Jean V (1). Ce fut donc à cette trahison de Marguerite de Clisson et de ses fils que la Roche-Derrien, rasée une première fois par ordre de Jean IV, en 1394, dut d'être rasée une seconde fois sous Jean V, en 1420. Le château ne fut pas cependant entièrement démoli, il subsista jusqu'aux guerres de la Ligue et fut rasé par ordre de Richelieu, comme nous le verrons plus tard, et à la demande même des États de Bretagne. Privée de ses fortifications, la Roche-Derrien ... ------------------ (1) Pendant sa captivité Jean V fait vœu d'ériger à Saint Yves un tombeau digne de lui et de donner pour cela son pesant d'or. Il demanda aussi plus tard d'être enterré dans la cathédrale de Tréguier près du tombeau de Saint Yves. ... cessait d'être une cité guerrière. Les rives du Jaudy ne retentirent plus des cris de guerre, du cliquetis des armes, du fracas des batailles, notre passé militaire s'était éteint comme s'éteint et finit tout ce qui est humain. De ce passé lointain le souvenir seul demeure avec le sentiment religieux, car nos pères ne furent pas seulement des guerriers, ils furent aussi des croyants. L'érection de la chapelle de Pitié à l'endroit même où tomba Charles de Blois, celle de trois croix plantées sur les ruines de l'ancien donjon (d'où le nom de calvaire donné à ce lieu), plus tard l'érection de la chapelle du même nom à cet endroit, ne semblent-elles pas avoir été voulues par nos pères pour nous indiquer l'orientation unique que nous devions donner désormais à nos vies et nous engager à tourner nos esprits et nos cœurs vers tout ce qui dure, vers Dieu, vers les choses éternelles et il semble que la leçon ait été comprise, puisque, aujourd'hui encore, les cérémonies religieuses revêtent ici un caractère de grandeur, qu'on ne leur voit pas toujours au même degré dans les localités de plus grande importance. Qu'il me suffise d'évoquer le souvenir de notre incomparable Congrès Eucharistique de 1929 et le passage plus récent de N.-D. de Boulogne à la Roche. |
![]()
CHAPITRE XVII LA ROCHE, APRÈS LA RUINE DE SES FORTIFICATIONS, EN 1420, N'EN RESTE PAS MOINS UN CENTRE IMPORTANT DE LA RÉGION. LES DE KERSALIOU Y EXERCENT A CERTAINS JOURS UNE INFLUENCE PRÉPONDÉRANTE. VIEILLES COUTUMES ROCHOISES. -----------------------
1° Even Yves, recteur de Troguéry, qui signa le 20 mai 1457, un missel écrit pour Jean Ynisan, vice-chancelier de Bretagne. 2° Salomon Robert, menuisier, qui fournit 5.5oo lattes pour la reconstruction du château de la Roche (début du XVIè siècle). 3° Du Parc Guillaume, orfèvre à la Roche-Derrien, au XIVè siècle, mentionné dans le procès de canonisation de saint Yves. 4° Cozic Nicolas, horloger à la Roche-Derrien, fut demandé à Quimper-Corentin en 1474 pour faire l'horloge de N.-D. de la Cité. 5° Auffret Jean, horloger à la Roche-Derrien, répara en 1593, puis en 1601 et en 1611, l'horloge de la cathédrale de Tréguier. 6° Surville Michel, qui répara, en 1651, la croix d'argent de la paroisse Saint-Jean de Trévoazan, puis, en 1668, la croix de cuivre de la même église. En 1669, il fit un calice d'argent pour Kerbors; en 1667. toute l'argenterie de Landébairon, enfin, en 1672, un calice d'argent pour St-Jean de Trévoazan, ainsi que la croix et le calice d'argent de Guénézan. Ce même Michel Surville, qui était horloger autant qu'orfèvre, fit, en 1667, l'horloge de la cathédrale de Tréguier (marché passé le 10 juillet 1667). 7° Jégou N., sieur de Kérusadou, peintre-verrier de la Roche-Derrien, répara les verrières de Pleudaniel, en 1713. 8° Quélen Jean, maître peintre à la Roche-Derrien, peignit les statues de N.-D. de Paimpol en 1620 et répara, en 1638, les verrières de la cathédrale de Tréguier. 9° L'Ancien Christophe, maître maçon de la Roche-Derrien, à qui est due l'œuvre du reliquaire de Pleudaniel, en 1734 (1). (1) Je dois cette nomenclature ainsi que la plus grande partie des renseignements qui concernent les de Kersaliou à Mlle Marthe Riou, fille de l'ancien maire et député de Guingamp. -------------------- La Roche avait aussi des tisserands dont le souvenir est rappelé par le nom d'une de nos rues : la rue aux Toiles; elle possédait aussi de nombreuses carrières dont les ardoises se vendaient dans toute la région. En 1771, Laurent Le Goaster, de Ploubazlanec, fut trouvé noyé, revenant en bateau de la Roche-Derrien, avec un chargement d'ardoises destiné à la communauté de l'Isle Verte, près de Paimpol.
Kersaliou Les seigneurs de Kersaliou, en Pommerit-Jaudy, eurent, dès le XIIIè siècle, une influence prépondérante à la Roche, où ils avaient aussi des juridictions de haut, bas et moyen exercice dans l'auditoire de la châtellenie. En 1245, Geoffroy de Kersaliou, seigneur de Chef du Bois, suivit saint Louis à la croisade. C'est ce gentilhomme qui à son retour aurait fondé l'hôpital de la Roche, pour soulager les misérables atteints de la lèpre. La famille de Kersaliou était d'ancienne extraction, elle portait d'argent et de gueules, de six pièces, au lion de sable armé, lampassé et couronné d'or. Brochant sur le tout cette devise : «Tout pour Dieu». Peu d'années avant 1880, le voyageur qui venait de Guingamp à la Roche, pouvait apercevoir sur sa droite, avant d'arriver à cette dernière ville, un manoir perdu au milieu de grands arbres, demeure modeste quoique spacieuse : c'était l'antique habitation de la famille de Kersaliou, appelée Chef du Bois (en breton Pen ar Hoat). Les seigneurs de Kersaliou en prirent le nom. Ce manoir a disparu et fait place à un magnifique château appartenant à la famille de Launay. Les archives nous renseignent sur quelques-uns des membres de la famille de Kersaliou de Chef du Bois. Le 15è jour de novembre 1433, mourut dame Katherine de Kersaliou, propriétaire de la seigneurie. Les comptes sont rendus par Alain Meryan, receveur de la seigneurie de Kersaliou. En 1449, cette seigneurie appartenait à dame Jehanne de Kersaliou. Plus tard, en 1482, ses possesseurs furent Olivier du Chatel et Marie de Poulmic. Claude du Chatel devint propriétaire en 1540. En février, ce même Claude du Chatel, baron de Marcé et vicomte de Pommerit, et Claude d'Acigné, sa femme, vendirent à Pierre de Boisgelin «la seigneurie de Kersaliou, avec prééminence d'église, enfeux, vitres, armoiries, pierres tombales, moulins, étangs, colombier, droit d'ancrage aux havres de la Roche-Derrien et de Lantréguier, etc., etc.». Jean de Boisgelin, à qui la
seigneurie passa ensuite, mourut au mois de mai 1655. Sa
fille aînée et héritière. Jeanne de Boisgelin,
épouse de Louis Rogon, seigneur de Carcaradec, lui En 1701, la seigneurie était a Vincent Rogon, seigneur de la Villéon. En 1767 enfin, la seigneurie de Kersaliou fut acquise par Louis-Annibal Rogon, seigneur de Carcaradec, à qui elle fut vendue par Louis Rogon, seigneur de Kersaliou. Une grande chapelle, du
côté de l'épître, dans l'église paroissiale de la
Roche-Derrien, était ornée de trois autels et décorée
des armes des Kersaliou. Au milieu de cette chapelle «une
tombe élevée sur laquelle étaient deux personnages en
bosse de pierre», qui ont été mutilés,
sans doute à la Révolution, était la sépulture des
membres de la famille de Kersaliou. 1° Droit et devoir d'ancrage sur les navires qui entraient dans la rivière, de Tréguier à la Roche et de la Roche à Tréguier, et droit d'ancrage sur les marchands des navires qui entraient dans la même rivière, depuis le pont de la Roche jusqu'à Tréguier et à la grande mer, à partir d'une pierre nommée «Men an Tarou» inclusivement. (Probablement le rocher appelé aujourd'hui Le Taureau, qui se trouve en effet en effet en mer, à l'entrée de la rivière.» 2° Le droit de foire et de coutume dans la ville de la Roche-Derrien. 3° Le droit de jeu sur les habitants. ----------------------- (1) Tous les droits dont l'énumération va suivre leur ont été affermés par les seigneurs de la Roche pour 9 livres tournois en 1605, 18 livres en 1656, 30 livres en 1679, 12 livres seulement en 1771. Le droit de foire et de coutume se prélevait sur la foire nommée «La foyre du gled». qui, se tenant à la ville, commençait «le jour de la feste de Monsieur Saint Barthélémy, au moys d'août, à 4 heures de l'après-midi, pour se terminer an soleil couchant du lendemain». Durant, ce temps, «le seigneur de «Kersaliou est seigneur de la dite ville et foyre;» il a le droit de prendre sur les marchandises «exposées, savoir : » De chaque mercier qui estale, une douzaine d'aiguillettes; de chaque boucher un os moëllier de bœuf et 4 deniers monnoie; de chaque tavernier nouveau, un pot de vin; dessus chaque boisseau de froment qui se vand à la foyre, 2 deniers monnoie et une joinetée de blé; pour chaque achapt d'avoine, 2 deniers monnoie : de chaque achapt de laine, 2 deniers monnoie. De chaque charge de chanvre ou lin broyé, 10 deniers monnoie; de chaque charge de fléaux, 10 deniers monnoie; de chaque cordier ou vandeur de corde, 1licol; de chaque charge de pots de terre, 10 deniers; de chaque vandeur de cruble, 1 cruble de chaque charge; de chaque charge de sacs à passer farinne, 1sac; dessus chaque charrette de bois, soit planches, limandes ou autres bois, œuvrés ou non, fagots ou busches, 20 deniers; dessus chaque charge de cheval, bois de charpente ou à feu, 10 deniers; de chaque marchand vandeur de drap, 5 deniers. De chaque cordonnier qui estale, 13 deniers; de chaque marchand vandeur de toille, 2 deniers; de chaque vandeur de chandelles, i chandelle. Dessus chaque ruche de mouches à miel vandue, 2 deniers; dessus chaque cheval, poulain ou cavalle vandue en la dite foyre, 8 deniers; dessus chaque beste à corne, 2 deniers; dessus chaque peau de vache ou bœuf, 4 deniers.» Voilà pour le droit de foyre et voici maintenant quels étaient les droits de coutume exigibles par les seigneurs de Kersaliou sur les marchandises vendues au marché de la Roche le vendredi : «Scavoir : De trois vendredis et jour de marché, un et premier : de chacun marchand mercier, hors d'icelle ville qui estale aux dits jours de marché, 1 obolle monnaie; de chacun vendeur de fusseau, 1 obolle; de chacun vandeur de vaisselle de bois et de panniers, 1 obolle; dessus chaque pochée ou acbapt d'avoine, 2 deniers; de chacun boucher qui vand chair et viande en la dite ville durant le cours de l'an, un quartier de mouton, au premier jour d'août pour chacun de l'an; de chaque potée de beurre, 1 maille de beurre; de chacun tavernier nouveau qui expose vin en vante, en caresme, en la dite ville et faute bourgs, 1 pot de vin de chacun, avec une dixième partie du devoir qui se prend sur les charges et pochées de sel, en la dite ville, par le prieur du dit lieu.» Cette longue énumération des droits de foire et de coutume est un peu fastidieuse, mais elle nous permet de nous représenter ce qu'était le commerce rochois à cette époque. Les droits de jeux achèvent de nous édifier sur ce qu'était la vie de nos aïeux aux siècles passés. Le seigneur de Kersaliou exerçait ce droit «sur tous les gens de métier, boulangers et artisans de la Roche-Derrien qui sont tenus d'élire des rois, reines ou ducs et de parcourir la ville en jouant et dansant, précédés d'un sonneur, pendant les quatre dimanches qui suivent, le pardon de l'église paroissiale». «Le premier dimanche défilent les boulangers avec leur reine; le deuxième dimanche les texiers, les cousturriers et tondeurs avec leur roi; le troisième dimanche les bouchers avec leur roi; les cordonniers avec leur duc et les marchands de chandelles avec leur reine; le quatrième dimanche les marchands, serruriers, perceterres et jardiniers avec leur roi, et les charpentiers et maçons avec leur duc.» Les défaillants étaient condamnés à payer au seigneur 60 sous et un denier d'amende. Il existait aussi jadis à la Roche, des coutumes assez curieuses; une d'entre elles, pratiquée encore il y a quelque cinquante ou soixante ans, est restée dans la mémoire des Rochois de ma génération. La veille de la Quasimodo, des hommes et des jeunes gens de la localité passaient dans nos maisons demandant qu'on leur remit les poteries et vaisselles fêlées ou ébréchées, gros pots de grès destinés à recevoir le lait, cruches à eau, etc., etc. Le lendemain, à l'issue des vêpres, ces mêmes hommes, munis de ces poteries, se livraient à un jeu de destruction désigné en breton sous le nom de «Coz poudou» (vieux pots). Parcourant à allure rapide les rues de notre ville et échelonnés à distance, ils se lançaient de l'un à l'autre ces vieilles poteries qu'il s'agissait de rattraper au vol. Et, c'était une joie lorsqu'un maladroit avait laissé choir et se briser à terre, un de ces ustensiles. Le jeu se poursuivait jusqu'à épuisement des munitions, en l'espèce les vieilles poteries. Cette coutume n'était pas spéciale à la Roche, elle se pratiquait dans toute la Bretagne et était très ancienne, mais à quelle idée correspondait-elle ?... N'était-elle pas un symbole ?... Pâques, fête de la Résurrection venait d'avoir lieu. Ces vieilles poteries qu'il s'agissait de détruire et qui seraient à renouveler, ne figuraient-elles pas le vieil homme que nous devons détruire en nous, pour renouveler nos âmes dans la grâce, afin de ressusciter nous-mêmes un jour avec le Christ ?... Je livre cette interprétation pour ce qu'elle vaut, car elle m'est personnelle et peut-être est-elle inexacte; mais elle n'est pas sans vraisemblance, si l'on considère d'une part la fête à laquelle elle se rapporte et, d'autre part, l'idée religieuse qui présidait à la plupart des actes de nos ancêtres, aux siècles de grande foi. Une autre coutume, non moins bizarre, était celle-ci qui remontait au Moyen Age, assurent les vieux historiens. Le lundi de la Pentecôte, les hommes et les jeunes gens de la Roche, précédés de tambours et d'un bouffon, se rendaient en grand cortège au village de la Villeneuve, quatre d'entre eux portant sur un brancard un veau écorché. A la Villeneuve, le bouffon faisait à l'assistance un discours de sa façon, après quoi la chair de l'animal était distribuée aux gens de ce quartier (1). Quelque temps après la visite des hommes à la Villeneuve, les jeunes filles de ce village se réunissant elles-mêmes en cortège venaient à la Roche portant sur la tête un immense pot de lait tout enguirlandé de fleurs. Les jeunes gens de la localité venaient les recevoir à l'une des portes de la ville et les conduisaient en grande pompe sur la place, où des tables avaient été dressées par eux à l'avance. Les jeunes filles y déposaient le lait qu'elles distribuaient aux jeunes hommes, et ceux-ci, l'ayant dégusté, leur offraient, à leur tour, un goûter qui se servait sur ces mêmes tables. (1) Peut-être est-ce en souvenir de cette vieille coutume que le lundi de la Pentecôte est encore aujourd'hui jour du pardon de Pitié, chapelle du quartier de la Ville neuve. ----------------------- Le lait versé par les jeunes filles aux jeunes gens n'était-il pas l'emblème de la douceur que la femme doit apporter au foyer et mettre dans la vie de l'homme et le goûter offert ensuite par eux, ne symbolisait-il pas l'obligation qu'à le mari de pourvoir à la subsistance de sa femme ? Venons-en maintenant à des coutumes plus modernes, mais qui, hélas ! périmées aujourd'hui, ne provoqueraient probablement que des railleries. Dans les jours qui précédaient le Carême, les jeunes gens de la Roche s'ingéniaient à créer un Mallargé, personnage grotesque qu'ils asseyaient le dimanche gras sur le sommet du puits couvert de notre place. Il y demeurait jusqu'au mardi suivant, semblant régner en maître sur notre ville et présider à la folle gaieté des masques, ses sujets. Mais le mardi gras venu, Sa Majesté, arrachée de son trône improvisé, se voyait mener, sous les injures, sous les huées de ces mêmes sujets au bord de la rivière où l'infortuné Mallargé, jugé, trouvé digne de mort, condamné au supplice du feu, n'était plus bientôt qu'une torche embrasée qu'on précipitait dans le Jaudy où s'achevait ou plus exactement... s'éteignait son règne éphémère. L'exécution de Mallargé préludait à l'entrée en Carême, temps de pénitence et de restrictions. Après les austérités qu'il comportait, une détente était indiquée. Les Rochois la trouvaient le mardi de Pâques dans leur fête annuelle du «Bouquet» qui était encore ici, il y a quelques 50 ou 60 ans, un jour de très grande liesse. Ce jour-là, les offices (grand'messe et vêpres), célébrés très solennellement, étaient suivis par une assistance nombreuse accourue ici de tous les points du canton. Les femmes rivalisant d'élégance venaient à la fête dans leurs plus beaux atours : c'était une profusion de grandes coiffes de dentelle, de châles brodés aux couleurs gaies, aux longues franges; de cachemires ou châles tapis, de beaux tabliers de soie, de satin ou de velours. Cela formait un magnifique ensemble, un véritable et, vivant parterre fleuri. Ces élégantes qui appartenaient à l'aristocratie du pays, arrivaient ici dès le matin pour assister à la grand'messe et prendre part ensuite aux grands galas qui avaient lieu ce jour-là dans toutes les familles notables de la Roche. A ces festins que n'eût pas dédaignés Pantagruel, étaient conviés le ban et l'arrière-ban des parents et, des amis. Ce mardi de Pâques m'est resté dans la mémoire comme un jour unique dans les fastes rochois. Au début de l'après-midi, pendant que se poursuivaient les agapes dans les principales maisons de la Roche, accourait ici, à son tour, toute la jeunesse campagnarde du canton, jeunes gens et jeunes filles dont la principale distraction allait, consister dans une interminable promenade du Chef-du-Pont au cimetière et du cimetière au Chef-du-Pont. On se groupait généralement au gré de ses sympathies, de sa parenté ou de ses relations et on allait en deux files très denses, l'une montant, l'autre descendant la rue de la Fontaine. L'affluence était telle qu'on avait peine à se frayer un passage entre ces deux files qui prenaient toute la largeur de nos rues. Ah ! cette promenade ! de combien de mariages n'a-t-elle pas été le prélude ? Ici, un vieux souvenir : Lorsque dans le croisement incessant des files (montante et descendante), un jeune homme de la campagne avait remarqué une jeune fille qui semblait répondre à son idéal, il quittait sa file, allait à elle, soulevait timidement son chapeau et, délicatement, sans mot dire, s'emparait du parapluie qu'elle tenait du bout des doigts, puis, le portant galamment, se mettait en marche à côté d'elle pour continuer la promenade. On se parlait peu, souvent pas du tout : le simple geste de la prise du parapluie avait été un hommage muet en même temps qu'un tendre aveu. A partir de ce jour on devenait des amis en attendant de devenir des époux. Nous jugeons d'après ceci que Chamberlin n'a rien inauguré, que le parapluie, l'indispensable parapluie de nos jeunes filles jouait déjà un très grand rôle en Bretagne dans les négociations matrimoniales. Une autre vieille coutume qui se pratiquait encore au temps de ma jeunesse, consistait à fêter le retour de la belle saison en plantant un «mai» sur notre place du Martray, un autre sur celle du Chef-du-Pont. Ces «mais» étaient de hauts peupliers que des hommes y apportaient sur leurs épaules et qu'ils dressaient ensuite au-dessus de fosses profondes qu'ils avaient creusées d'avance pour en recevoir le pied. Le «mai», au sommet duquel flottaient les couleurs françaises, restait sur place toute la durée du mois dont il portait le nom. Une vieille habitude des ouvriers rochois était les dimanches, après l'assistance aux offices (messe et vêpres, auxquels ils étaient très fidèles), de consacrer les loisirs de la soirée à de bonnes et passionnantes parties de quilles, jeu qui était ici jadis en honneur. Les femmes se livraient, également le dimanche, à un jeu qu'elles appelaient en breton : " c'hoari poullig ". Pour y participer il fallait se procurer des noix dont on avait à l'époque une dizaine pour un sou et ces noix étaient mises en commun. Le jeu, semblable au jeu de billes des enfants, consistait à viser un petit trou creusé en terre et à lancer dans sa direction une poignée d'un nombre déterminé de noix. Celles-ci ainsi projetées de loin tombant à terre roulaient en tous sens; celles qu'une adroite joueuse avait réussi à faire pénétrer dans le «poullig» (le petit trou) lui étaient acquises, devenaient sa propriété. La partie achevée, l'heureuse gagnante partageait aimablement son butin avec ses partenaires et ses amies. «Bean po eur c'houblad kraou ?» telle était souvent la formule employée pour leur offrir une couple de noix. Toutes ces vieilles coutumes constituaient d'innocentes et saines distractions que remplacent aujourd'hui, fort désavantageusement pour la morale, les bals et les cinémas. Un jour de grande affluence à la Roche était le vendredi jour de marché; on y venait de toutes les localités des environs et notre Place ce jour-là, était, grouillante d'une foule qui débordait dans nos rues. Le marché aux grains et aux pommes de terre se tenait devant le portail de l'ancienne communauté des religieuses (aujourd'hui école communale), celui de la volaille, des œufs, du beurre et du lait devant le Café de la Poste. Ce dernier marché (beurre et lait), avait lieu d'ailleurs tous les jours, mais était plus particulièrement fourni le vendredi. Dès le matin y accouraient les fermières, portant sur la tête de grands pots de grès remplis du précieux liquide dont on allait, s'approvisionner là, au lieu de le faire, comme on le fait aujourd'hui, dans les fermes ou dans les épiceries. Comme tous les marchés, ce marché du vendredi nous amenait des forains dont les boutiques couvraient notre Place, débordant parfois jusqu'à la rue de EGLISE Pourquoi ce marché n'existe-t-il plus ?... Il y a eu à cela deux raisons : La première fut une question de droits que le maire de l'époque voulut imposer sur les sacs de blé et de pommes de terre, ce qui provoqua le mécontentement des cultivateurs et les détermina à porter ailleurs leurs denrées. Une seconde raison fut l'expulsion de nos religieuses, et partant la suppression de leur pensionnat, qui se produisirent à la même époque. On comptait parmi les pensionnaires un grand nombre de jeunes filles des meilleures familles de la campagne, dont les parents avaient adopté le vendredi pour venir les voir. Cette décision leur permettait, en même temps, d'écouler ici leurs produits et d'y faire les achats qu'ils eussent pu faire ailleurs. N'ayant plus de raison particulière pour venir à la Roche, attirés dans d'autres localités par les enfants qu'ils avaient dû y mettre en pension, ils nous délaissèrent et ce fut la chute de notre marché. Cette expulsion des religieuses fut fatale au commerce rochois, non seulement en lui ôtant la clientèle du vendredi, mais en la privant de la grosse ressource qu'était pour lui, toute l'année, le ravitaillement en produits alimentaires, en vêtements, en chaussures, etc., de cet important pensionnat. Un autre marché, assez curieux, spécial à la Roche, celui-ci, et tout temporaire, avait, lieu ici dans la dernière quinzaine de juin et la première quinzaine de juillet; c'était le marché des «badies» ou merises. Les merisiers, qui tendent aujourd'hui à disparaître, abondaient encore dans notre région, au temps de ma jeunesse. Mous avions donc le marché des badies et le monopole de la vente de ce fruit. Ce bizarre marché, qui avait lieu à 3 heures du matin, offrait à la jeunesse de mon époque, peu habituée aux veillées, le même attrait que présentait la perspective d'une messe de minuit. Dès 2 heures 30 matin, des femmes de la campagne, portant sur leur tête de grandes mannes remplies de badies, arrivaient en notre ville et se réunissaient, les unes sur la Place, les autres en plus grand nombre au Bas-du-Pont, et là, assises sur des escabeaux, derrière leurs mannes déposées à terre, en un vaste demi-cercle, elles attendaient la clientèle. Celle-ci se composait de marchands de Lannion, de Tréguier, de Pontrieux, de Guingamp, de Paimpol et d'ailleurs, qui, après avoir goûté la marchandise et s'être assurés de sa qualité, achetaient en gros le contenu des mannes pour aller ensuite le détailler chez eux. Un souvenir de jeunesse se rattache pour moi à ce marché de badies. Sur la suggestion d'amies de mon âge, curieuses, comme je l'étais moi-même, de voir ce marché, et pour qui la perspective d'un lever si matinal était un enchantement, je demandai et obtins de mes parents l'autorisation de les y accompagner. Affectant d'être des acheteuses, nous allâmes de panier en panier, demandant les prix et examinant la marchandise. Je doute que les vendeuses se soient laissé prendre à notre jeu, mais avec une bonne grâce et une générosité charmantes, elles nous engageaient vivement à goûter de leurs fruits, ravies, dans leur bonté, de faire plaisir à cette jeunesse qui avait écourté son sommeil pour venir les voir. Et ainsi, de panier en panier, nous avions été copieusement régalées sans bourse délier.- |
![]()
CHAPITRE XVIII LA ROCHE-DERRIEN DE 1420 A LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. ELLE FAIT CORPS AVEC LA BARONNIE D'AVAUGOUR. LA LIGUE EN BRETAGNE. -- MERCŒUR, DESTRUCTION DU Château DE LA ROCHE. ÉTAT DE LA VILLE A LA RÉVOLUTION. -------------------------
En 1479, sous François II, les États de Bretagne, assemblée à Vannes, supplièrent le duc de créer baron d'Avaugour (première baronnie du duché), François de Bretagne, son fils naturel. Pour faire le corps de cette baronnie, François II "joignit ensemble : Avaugour, Chatel-Audren, Lanvollon, Pempol et le Goëllo", plus tard, avec le consentement des notables réunis à Nantes, il y ajouta «La Roche-Derrien, Chateaulin-sur-Trieux et Clisson», substituant à François de Bretagne, au cas où il mourût sans enfant, Antoine de Bretagne son autre fils naturel, ci-devant appelé messire Dolus, alors seigneur de Châteaufroment et depuis de Hédé. Ainsi donc la seigneurie de la Roche-Derrien devint propriété du nouveau baron d'Avaugour, frère illégitime de celle qui, à la mort de leur père François II, devait devenir la duchesse Anne de Bretagne, et plus tard la reine de France. Des troupes françaises se trouvaient en Bretagne quand Anne devint duchesse, et quoique des négociations de paix fussent entamées, continuaient à piller et à menacer les villes. Guingamp fut occupé par elles, puis deux fois la ville de Pontrieux fut saccagée, après quoi les Français vainqueurs y mirent le feu, avant de regagner Guingamp. Le lendemain de cette défaite, le capitaine Gouicquet qui s'était retiré à la Roche-Derrien, averti qu'une troupe d'Anglais de 1.500 hommes s'était montrée du côté de Bréhat, alla les trouver et décida les chefs à venir à Pontrieux. Les Français, en l'apprenant, prirent, l'alarme et abandonnèrent le même jour Guingamp, qui dût ainsi sa libération à une initiative partie de la Roche. Notre cité connut, après 1420, une ère de paix dont elle n'avait pas joui au temps de sa grandeur militaire. Son château existait toujours, mais privé des moyens de défense qui en faisaient jadis une forteresse. Telle était la situation de la Roche quand éclatèrent les guerres de la Ligue. Henri III en montant sur le trône de France, avait épousé Louise de Lorraine, fille du comte de Vaudemont et sœur du duc de Mercœur Le roi prit dès lors Mercœur en amitié et lui fit épouser Marie de Luxembourg, comtesse de Penthièvre et vicomtesse de Martigue. Il fit encore plus pour son beau-frère : il ôta le gouvernement de la Bretagne au duc de Montpensier, prince de son sang, pour le donner à Mercœur. C'était agir contre les lois de la politique que de confier un gouvernement de cette importance à un prince qui avait, du chef de sa femme, des prétentions à la souveraineté de cette province. Quand éclatèrent les guerres de la Ligue, Mercœur, désireux de soutenir la religion catholique et de soustraire la Bretagne à la domination d'Henri de Navarre, prince hérétique qui devait succéder à Henri III, prit parti contre le roi, son beau-frère et son bienfaiteur. II entra en guerre contre lui et, pendant douze ans, continua la lutte. — Sa femme, la comtesse de Penthièvre, le pressait de profiter de cette circonstance pour faire recouvrer à la Bretagne son indépendance et s'en rendre le souverain. Ayant mis au monde un fils, elle voulut même, en vertu de ses droits, comme comtesse de Penthièvre, qu'on le nommât Prince de Bretagne, mais l'enfant mourut l'année suivante. Mercœur fut un moment
maître de presque toute la Bretagne, mais il ne prit
jamais le titre de duc de cette province : sa grande
ambition fut de conserver la foi catholique en Bretagne. Sous Louis XIII, une conspiration tramée par le comte de Chalais, ayant éclaté contre Richelieu, celui-ci fît décapiter le Comte et ses soupçons s'étendirent aussi, à César de Vendôme, le gendre de Mercœur. Le Cardinal l'obligea à faire démolir à ses frais les châteaux de Lamballe, de Guingamp, de Moncontour que sa femme lui avait apportés en dot, et ce fut alors aussi, que fut complétée la destruction de ce qui avait été le château-fort de la Roche-Derrien, qui faisait partie du domaine des Penthièvre. Aucun événement important ne se produisit ensuite à la Roche, où la vie suivit son cours normal jusqu'à la Révolution française. Nous savons seulement que de l'antique ville fortifiée fondée par Derien, les trois portes étaient, seules demeurées comme des témoins du passé. Ces portes étaient désignées sous les noms de Porte des Toiles, Porte du Moulin et Porte de la Jument, celle-ci encore appelée en breton, il y a une soixantaine d'années «Porz-ar-Gazec». Cette porte datait de l'an 1297. Elle était située un peu plus bas que l'hôpital et dans la même direction : c'était simplement une poterne s'ouvrant au bord de la rivière et elle devait servir, d'après son nom, à mener les chevaux à l'abreuvoir. Le passage qui conduisait à cette porte était couvert et aujourd'hui encore on en voit l'entrée dans la cour d'une maison donnant sur le Jaudy (celle de Mme Toupin). Quant à la porte du moulin, elle devait conduire auprès d'un manoir appelé Keravel, c'est-à-dire ville du vent, manoir qui existe encore aujourd'hui, en face de la chapelle actuelle de Pitié. Il y eut autrefois sur l'emplacement qu'occupé cette chapelle, un moulin à vent, ce moulin contre lequel s'adossa l'infortuné Charles de Blois pour tenir tête à ses ennemis et qui vit sa défaite.
En 1766 il dut y avoir à la Roche une épidémie sur les jeunes enfants. Les États Civils révèlent qu'il y eut cette année là 78 enterrements dont 52 d'enfants de 0 à 10 ans. Les archives nous ont conservé quelques noms de rues de la Roche d'autrefois : il y avait la rue de Lourme, la rue du Puits (Ru ar Puns), la rue du Créc'h, la rue de la Vigne, la rue Babiou (pluriel breton de babi) parce que, probablement le marché de ce fruit se tenait dans cette rue); la rue du Martray, la rue du Château, la rue aux Toiles, le Pouilhet, Fontaine au beurre, la rue et la place du Pilori, la rue de la Fontaine (Ru ar feuntenn) qui est, aujourd'hui la rue principale, etc. Il paraît que longtemps avant la Révolution, la Roche-Derrien avait cessé d'avoir un commandant militaire. Il s'y trouvait seulement une maison de remonte pour la cavalerie royale. Cette maison de remonte dut être supprimée plus tard pour faire place a un dépôt de remonte que j'y ai connu dans ma jeunesse et qui depuis a été transféré à Tréguier. Les autorités civiles de la Roche, avant la Révolution, étaient un sénéchal, un syndic et un procureur fiscal. Le seigneur de la ville, en 1789, était le Prince de Rohan-Soubise, auquel devait succéder le Prince de Condé, qui légua au duc d'Aumale les derniers biens qu'il possédait sur la paroisse de la Roche-Derrien. |
![]()
CHAPITRE XIX PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE A LA ROCHE --------------------------
Ière Pièce. — Pontrieux. Liberté ou la mort. Reçu, au quai de cette ville, par la voiture du citoyen Le Goaster de la Roche-Derrien, savoir : 1° Deux cloches, nos 128 et 129, provenant de l'église de la Roche-Derrien, dégarnies de leurs montants et battants. 2° Une cloche, n° 130, de la chapelle de Pitié. 3° Autre 182 de la chapelle de St-Jean, les deux également sans montants ni battants. 4° Autre cloche, n° 131, avec son buttant, provenant de St-Eutrope, dont décharge. Réservant au preneur l'envoi des dits montants et battants et les cuivres des dites églises et chapelles. Et sera payé du prix de la voiture, par la municipalité de la Roche, sur les fonds de la fabrique. Ce 23 pluviose, an 2 de la République une et indivisible. Signé : DANIEL (1).
1° Six cent trente deux livres de chiffons de toile; 2° Deux cent dix huit livres de plomb, provenant de l'église. L'agent national du district de Pontrieux. Signé : POUHAER. (1) Les cloches descendues de notre église après la Révolution de 1789, durent être remplacées, mais le 28 février 1889 on en baptisa deux nouvelles : la plus grosse, nommée Catherine-Marie-Julie, eut pour parrain M. Y.-M. Gélard, maire de La Roche, et pour marraine Mme Julie Tily, née Connan. La seconde, appelée Jean-Baptiste, fut nommée par M. l'abbé Jean-Marie Parquer, curé-doyen de La Roche, et par Mme Catherine Guillou, née Lourec. 3ème Pièce. — Pontrieux. Ce jour, 4 nivôse, an 3 de la République une et indivisible, la commune de la Roche-Derrien a fait déposer aux magasins de ce district, six cent quarante sept livres de vieille ferraille, deux assiettes, deux cuillers, et deux arceaux d'étain, du poids de trois livres et un quart; un plat, un chandelier et un coq de cuivre jaune du poids d'une livre deux onces. Quatre pièces de potin, avec une petite cloche pesant trente quatre livres, provenant des églises de la dite commune. Signé : PARANTHOEN, GUIOT, LE GORREC. 4ème Pièce,. — Les administrateurs du Directoire du district de Pontrieux reconnaissent que la municipalité de la Roche-Derrien a fait déposer au secrétariat du district de Pontrieux les objets suivants provenant des églises de la dite commune et devant être les restes des ustensiles réservés pour le service du culte. Savoir . Un calice avec sa patène d'argent doré. Un ciboire d'argent. Une petite boîte à huile, aussi d'argent. Un croissant doré, provenant d'un soleil. Fait au Directoire, Pontrieux, 5 prairial, an 2 de la République une et indivisible. Signé : PARANTHOEN, GUIOT, LE GORREC. 5ème — II a été remis au magasin du district de Pontrieux de la part de la municipalité de la Roche-Derrien, les effets suivants qui proviennent de son église; savoir : Sept linceuls, cinq surplis, neuf aubes, cinquante-deux nappes, quatorze amicts, vingt-et-un corporaux, vingt-neuf essuie-mains, cinquante-cinq mauvaises nappes et trois petites poches. La dite remise faite le 5 courant. Le 8 messidor, an 2 de la République une et indivisible. PARANTHOEN, GUIOT, LE GORREC. 6ème — Je soussigné, secrétaire du district de Pontrieux, reconnais que le citoyen Connan, agent national de la commune de la Roche, a déposé au magasin de Pontrieux destiné à cet effet : Six cent douze livres pesant, provenant, tant de vieilles marmites que ferraille, boulets de canon et d'un vieux pierrier, et qu'il a aussi déposé au même magasin, les cordes des cloches descendues de la dite commune et autres, duquel dépôt je lui ai donné le présent reçu, ce jour, 28 prairial, an second de la République une et indivisible. Signé : LE GORREC. 7ème Pièce. — Le 27 messidor, deuxième année républicaine, il a été déposé au magasin du district de Pontrieux, de la part de la municipalité de la Roche-Derrien, les objets cy après, provenant de la cy devant église; savoir : Huit chapes, vingt-une chasubles, quatre dalmatiques, vingt-huit manipules, vingt-six voiles, vingt-deux tuniques, seize custodes de la palle, vingt-neuf étoles, deux dais, une bannière, dix-sept coussins, dix-neuf rideaux, un drap mortuaire, soixante-quatorze devants d'autel, une robe, quatorze cordons, une couverture de ciboire, une petite boîte, une petite bourse, une porte de calice, quatorze corporaux, plus un purificatoire. De tout quoi décharge. Signé : PARANTHOEN, GUIOT, LE GORREC. En plus 6 missels, treize processionnaux, deux rituels, deux graduels, deux vespéraux. 8ème Pièce, -- Les administrateurs du district de Pontrieux reconnaissent que le citoyen le Goaster, officier municipal de la commune de la Roche-Derrien a déposé à l'administration; savoir : Cinq bons chandeliers de cuivre. Trois croix de même métal. Deux bénitiers, idem. Deux lampes, idem. Une cloche cassée, idem et divers autres morceaux de cuivre provenant de l'église de la même commune. Diverses ferrailles provenant des dépouilles des cloches de la même commune. Signé : PARANTHOEN, GUIOT, LE GORREC. De cette période de fièvre révolutionnaire à la Roche-Derrien, un épisode doit être rappelé : Chef-du-Bois appartenait en 1791, à la famille de Ruys qui dût bientôt émigrer. Cette propriété, vendue comme bien national, fut acquise par Le Roux, notaire à la Roche-Derrien et bien connu par la violence de ses opinions révolutionnaires. Devenu juge au tribunal criminel de Lannion, Le Roux prononça la condamnation à mort de deux prêtres et celle de Mme Taupin, femme du valet de chambre de Mgr Le Mintier dont le seul crime était d'avoir donné asile à des prêtres réfractaires. Elle fut exécutée sur la place de Tréguier, en face de sa maison et sous les yeux de ses enfants. Son mari qui avait accompagné Mgr Le Mintier dans son exil, rentra en France, se fit chouan, arriva de nuit à Chef-du-Bois, où Le Roux reposait tranquillement. Là, se passa un drame qui n'eut que Dieu pour témoin : le royaliste, vengeant sa femme, tua Le Roux d'un coup de pistolet. Certains prétendent même que Taupin, aidé de ses amis, traîna ensuite le cadavre jusqu'au Jaudy, où ils l'auraient jeté ou plus probablement enterré dans la vase, mais ceci n'est pas certain. Ce qu'il y a de sûr c'est que le Roux fut tué; ce qu'il y a de vrai aussi, c'est que dans ma jeunesse j'ai entendu dire qu'un squelette d'homme venait d'être trouvé enfoui dans la vase, à peu près à l'endroit où aurait été jeté le cadavre de le Roux, c'est-à-dire entre le Pont-Neuf et l'endroit connu sous le nom de Bois-du-Renard. Les archives révèlent que le 1790, il se tint une assemblée de la Garde Nationale de la Roche-Derrien dans la chapelle Saint-Eutrope de l'Hôtel-Dieu. Cette chapelle dépouillée de tous ses ornements, servit à différents usages de 1789 à 1804, époque à laquelle elle fut rendue à sa destination primitive. |
![]()
FONDATION DE LA PREMIÈRE ÉCOLE DE FILLES A LA ROCHE. SON HISTOIRE JUSQU'A NOS JOURS. — LES INVENTAIRES. -------------------------
Émues de cette triste situation, les autorités (civile et religieuse), firent appel aux Filles du Saint-Esprit qui vinrent s'établir ici en 1818 et y fondèrent des classes. Elles eurent beaucoup à souffrir de la misère; on les avait fait venir, mais nul n'avait songé à assurer leur subsistance; leur détresse était extrême : les pauvres religieuses mouraient littéralement de faim. Cette triste situation ne devait se modifier qu'à l'avènement au supériorat de la Sœur Saint-Michel, dite : «Bonne Mère», qui lutta avec une indomptable énergie contre les difficultés, adjoignit aux classes qui existaient à son arrivée ici, un pensionnat, donna une nouvelle impulsion aux études qu'elle orienta vers l'obtention des brevets et fit de son établissement une maison d'éducation renommée, où les pensionnaires accouraient de partout. A la mort de «Bonne Mère» la prospérité de l'établissement était à son apogée (26 septembre 1890), elle se maintint jusqu'en 1902. Un vent de tempête soufflait à cette date sur les Écoles chrétiennes. Celle de la Roche était trop réputée pour ne pas attirer l'attention des persécuteurs : l'orage devait éclater sur elle. Un coup de tonnerre foudroyant, l'expulsion, la brutale, la honteuse expulsion des religieuses, vint, renverser d'un coup l'édifice si péniblement construit par «Bonne Mère» (14 septembre 1902). J'aurai toujours devant les yeux le spectacle de ces onze religieuses chassées de leur Communauté, la supérieure marchant en tête, conduite par M. le Provost de Launay, sénateur-maire, la poitrine barrée de son grand cordon, et derrière elle, marchant à la file, les autres religieuses conduites chacune par un conseiller municipal; car ces messieurs avaient voulu donner aux saintes filles expulsées ce témoignage de leur estime et de leur respect. Ce fut comme un cortège de noces, mais de tristes noces : les religieuses épousaient la douleur ! Elles défilèrent sur la Place, au milieu d'une foule de sympathisants, accourus ici de toute la région pour protester avec indignation contre cette expulsion. Tous les accompagnèrent à l'église, où furent chantés un Miserere et un Parce Domine d'expiation, et les conduisirent ensuite dans la maison amie où elles avaient trouver asile. Elles y vécurent petitement de quelques leçons données par ci par là et de travaux de couture exécutés dans leur ouvroir. Le récit de cette expulsion serait incomplet, si je ne disais que le jour où elle eut lieu, la Roche avait été déclarée en état de siège et qu'on avait réquisitionné les brigades de gendarmerie de Lannion, de Tréguier, de Pontrieux, pour renforcer celle de la Roche, tant les persécuteurs redoutaient la colère du peuple, sincèrement, acquis à ces religieuses qui n'avaient fait ici que le bien. Après l'expulsion, le zèle de M. le chanoine Menguy, curé de la Roche-Derrien, ne resta pas inactif. Aidé de quelques dons généreux (le plus important fut celui de la famille Fleury), et, des subsides de la Maison-Mère des Filles du Saint-Esprit, il acheta un terrain, fit construire une école libre qui fut ouverte aux élèves le 18 septembre 1911. La bénédiction de cette école eut lieu le 8 octobre. On y porta solennellement les trois crucifix des classes et la belle statue de sainte Catherine, la patronne du nouvel établissement dont les Religieuses avaient déjà pris possession. Entre temps, le samedi 3 mars 1906, notre église avait été visée à son tour par les persécuteurs et notre clergé mis à l'épreuve : on était à l'époque odieuse des Inventaires. De 7 heures du matin à 11 heures on chercha vainement des crocheteurs pour forcer les portes de l'église; il ne se trouva pas un Rochois pour l'accomplissement de cette criminelle besogne. Elle fut enfin exécutée par un étranger de passage, le conducteur du grand rouleau à vapeur, auquel, en désespoir de cause, on avait eu recours et qu'on avait dû payer largement pour un pareil office. Protestation du curé, M. l'abbé Menguy, du Conseil de Fabrique, et des paroissiens, qui s'étaient enfermés dans l'église, indignés de celte atteinte portée à leurs sentiments religieux et à leur liberté de conscience. Je disais plus haut que les
Filles du St-Esprit s'établirent à la Roche en 1818;
mais voulant épuiser d'un seul coup le sujet qui les
concerne, afin de le faire embrasser dans son ensemble, j'ai
présenté un résumé de leur histoire jusqu'à nos
jours et la persécution dont elles furent l'objet, m'a
entraînée à parler d'une autre persécution, celle des
Inventaires. Il nous faut maintenant revenir en arrière. |
![]()
CHAPITRE XXI LA ROCHE DU PREMIER EMPIRE AU SECOND EMPIRE JUSQU'A LA GUERRE DE 1870. ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA. — INONDATION. --------------------------
La Roche-Derrien ne possédait que trois maisons au delà de son vieux pont. En 1889, cependant, par ordonnance du roi Louis-Philippe, on y rattacha tout le polygone qui forme le quartier de, Chef-du-Pont, appartenant autrefois à Langoat. Ce quartier comptait alors 105 habitants, de sorte que la population rochoise s'éleva à plus de 1.600 habitants. Elle en avait accepté jadis 1.770. Notre ville a dû être bien plus populeuse autrefois, avant qu'elle fut minée par tant de guerres dont elle fut la victime. L'enceinte de la ville n'était pas très étendue, mais les faubourgs ont dû être considérables, si on en juge par la quantité d'anciens fondements que l'on a trouvés dans les champs qui environnent la ville. La chapelle Saint-Eutrope existait encore en 1850, elle fut démolie peu après cette date et remplacée par un modeste oratoire, dédié au même saint, dans l'intérieur même de l'établissement des Filles du Saint-Esprit. En 1867, il y eut à la Roche une terrible épidémie de choléra. La mortalité était effrayante et la terreur à son comble : on comptait deux, trois, quatre ou cinq enterrements par jour. Dans un seul mois, celui de mars, il y eut 120 décès. Par peur de la contagion, chacun fuyait les malades. La Supérieure des Filles du Saint-Esprit, Mère Saint Michel, «Bonne Mère», y trouva l'occasion de révéler les trésors de charité que renfermait son âme, de jour et de nuit, sans repos ni trêve, elle fut au chevet, des malades, soignant les corps, réconfortant les âmes et ne s'accordant un peu de répit que lorsque ses forces épuisées la trahissaient. Pour la récompenser de ce noble dévouement, les hommes lui décernèrent la médaille d'argent des épidémies : Sa véritable récompense, la seule qu'elle ambitionnât, elle l'a reçue depuis au ciel. Monseigneur David, évêque de Saint-Brieuc, ému du fléau qui désolait la Roche, y vint pour voir et encourager les malades. Ce fut «Bonne Mère» qui l'accompagna dans les visites qu'il leur fit. J'aurai donné une idée de la virulence de ce fléau que fut ici le choléra, lorsque j'aurai dit que la servante de ma grand'mère qui s'était couchée bien portante un soir, fut trouvée morte dans son lit le lendemain matin. En découvrant ce cadavre, ma grand'mère, affolée, appela à l'aide. Une sainte fille qui revenait de l'église, où elle avait assisté à la messe et fait la sainte communion, entendit son appel, entra et s'offrit pour ensevelir la morte : le lendemain, victime probablement de cet acte charitable, elle avait elle-même cessé de vivre. Puisque j'en suis aux fléaux, je laisserai momentanément la guerre de 1870 qui, dans l'ordre chronologique, aurait dû trouver sa place ici, pour y revenir plus tard et j'aborderai de suite le récit d'une très grave inondation qui survint à la Roche en 1880. J'avais alors 13 ans. Des pluies torrentielles et persistantes avaient multiplié les rigoles, grossi les ruisseaux, crevé les chaussées des étangs et fait déborder les rivières qui recevaient toutes ces eaux. Notre pacifique Jaudy était devenu un torrent furieux qui. sortant de son lit. avait envahi toute la rue de la rive du côté du lavoir, et avec elle toutes les maisons qui la bordent. Les habitants avaient dû fuir, abandonnant leurs meubles que l'eau baignait à mi-hauteur. Cette situation, déjà pénible, durait depuis deux ou trois jours, lorsque soudain, un certain samedi soir, un nouvel et formidable afflux d'eau la rendit subitement très grave. Mon frère, rentrant de la ville (nous habitions alors au delà du vieux pont et des maisons rattachées à la Roche en 1839), nous dit avoir été effrayé de l'état de la rivière : «Elle a encore grossi, nous dit-il, le courant est terrible et le bruit de l'eau effrayant. Venez donc au pont avec moi, il faut voir cela.» Et il nous entraîna, mon père, ma mère et moi. Nous allions arriver au pont, quand un grand cri déchirant, cri d'angoisse et d'épouvanté retentit soudain à nos oreilles. Oh ! pensâmes-nous, «c'est probablement encore une scène de ménage entre les habitants de cette maison; on les en dit coutumiers.» Mais au même moment, nous vîmes (la fenêtre était grande ouverte et la maison éclairée) la femme de l'aubergiste du Cheval Blanc, celle-là même qui avait poussé le cri, enjamber une table qui était, à sa portée et s'y tenir debout, jetant autour d'elle des regards terrifiés. Il devint évident alors qu'il ne s'agissait pas d'une querelle de ménage, mais d'un danger quelconque. Nous nous approchâmes de la fenêtre et, stupéfaits, nous vîmes la maison déjà envahie par l'eau et le flot, grossissant toujours, entraîner dans la pièce, barriques et bouteilles rencontrées sur son passage dans l'arrière-cuisine qui servait de cave. La cour très longue de cette maison se terminait en effet du côté de la rivière, dont un mur seulement la séparait. Le nouvel afflux d'eau de ce samedi soir avait rendu le barrage du mur insuffisant : il avait été débordé, d'où l'envahissement de la cour et de la maison. — En bien moins de temps qu'il m'en a fallu pour le consigner ici, les pieds de la femme, debout sur sa table étaient atteints par l'eau. Tandis qu'on s'efforçait de la sortir de sa fâcheuse position, l'idée nous vint que la maison voisine, dont le jardin confinait lui aussi à la rivière, courait le même risque et nous fûmes avertir ses occupants du danger qui les menaçait. A peine, en effet, les avions-nous alertés, qu'un bruit de cascade se fit entendre : c'était le flot atteignant les marches d'une cave en sous-sol et s'y précipitant pour l'inonder. Il fallut hâtivement alors faire la chaîne pour sauver des balles de lin déposées dans cette cave et dans les magasins établis le long du jardin. Mais au milieu de ces soucis on avait oublié un malheureux cheval dont l'écurie confinait à la rivière; il fallut aller le cherche et le ramener à la nage; il allait être infailliblement noyé. Mais ces incidents, pour sérieux qu'ils fussent, n'étaient rien en comparaison de ce qui allait suivre. Lorsque, la chaîne finie, nous regagnâmes le pont, nous pûmes constater que son arche était devenue insuffisante pour permettre l'écoulement complet de l'énorme masse d'eau nouvellement reçue. Il en résultait que cette eau, du côté de l'amont, y avait gagné en hauteur, au point d'affleurer au niveau du parapet. La pression qu'elle exerçait sur le pont était terrible, on le sentait frémir sur ses assises, on avait l'impression qu'il allait être emporté et, en effet, d'un côté il commençait déjà à se détacher de l'auberge qui y est attenante. Cette maison elle-même, ainsi que le moulin qui y faisait face, donnaient des inquiétudes. Certains craquements avaient inquiété les personnes qui l'habitaient. Celles-ci, obéissant à une heureuse inspiration, allèrent réveiller et lever leurs enfants qui reposaient dans des lits accotés au mur du pignon donnant sur la rivière. Bien leur en prit, cinq minutes après il eût été trop tard car brusquement ce pignon s'effondra: entraînant dans sa chute les lits des enfants, qui venaient presque miraculeusement d'échapper à la mort. Un instant après, toute la façade du moulin, situé en face, s'écroulait, à son tour, dans un fracas de pierres et ce fut encore miracle que le meunier n'eût pas été entraîné dans la chute. Je le vois encore, au moment où se produisit l'effondrement, se rejeter brusquement en arrière, les bras levés vers le ciel dans un geste d'indicible épouvante : il venait, lui aussi, d'échapper à la mort. Nous vivions les moments les plus angoissants de cette soirée. Les trépidations du pont étaient devenues de plus en plus inquiétantes, personne n'osait plus s'y aventurer. Mon père, cependant, devant l'effondrement du moulin, voulut le traverser pour aller aider le meunier à sauver les sacs de farine que l'on voyait, à travers la façade béante, prêts à glisser dans les flots. Je voulus le retenir en me cramponnant à ses vêtements : il parvint à m'échapper et s'engagea sur le pont. Alors, désespérée, convaincue qu'il allait à la mort, je le suivis, le saisis par les jambes, paralysant ses mouvements, pleurant et criant : «Papa, vous ne passerez pas !» Hélas ! il était plus fort que moi ! Il passa, porta secours et revint sans encombre, le pont ayant tenu; mais quels moments d'angoisse j'ai vécus ce soir-là. Cette tragique soirée du samedi eut, le lendemain, dimanche, sa contre-partie tragi-comique. Le moulin des Près était inondé depuis quelques jours déjà; les champs environnants el la route de Mantallot étaient sous l'eau, celle-ci coupée entre Sitol et Pilbara. Les habitants du moulin avaient dû évacuer le rez-de-chaussée de leur maison, envahi par l'eau et se confiner dans la pièce du premier étage. La recrudescence de crue du samedi soir fit encore monter les eaux qui gagnèrent la pièce dans laquelle s'étaient réfugiés les meuniers. Sous leur poussée les vitres avaient cédé. Le courant, terrible, entrait par une fenêtre, pour sortir par la fenêtre du côté opposé, rendant tragique la position des meuniers, obligés de se cramponner aux meubles pour n'être pas entraînés. Leurs appels au secours avaient-ils été entendus ou leur situation devinée ?... Toujours est-il que ce dimanche, pendant la grand'messe, au moment du prône, la porte de l'église fut brusquement ouverte, en même temps que retentissait ce vibrant cri d'alarme : «An dour ! An dour !» (L'eau ! l'eau !) C'était, paraît-il, un appel aux hommes pour aller au secours des sinistrés du Moulin des Prés. Parmi les fidèles qui se trouvaient à l'église, les uns avaient bien compris qu'il s'agissait de l'eau, de l'inondation, et sans réfléchir dans l'émotion du moment à l'absurdité de leur hypothèse, pensaient que la crue (chose matériellement impossible) allait atteindre l'église. Les autres, 'ayant mal entendu et compris : «An tour ! an tour !» c'est-à-dire «la tour», crurent que la tour, minée par les pluies torrentielles des jours précédents, allait s'écrouler. Ce fut alors dans l'église une panique indescriptible; on se rua vers les portes, se bousculant, se poussant, se tirant, se piétinant pour échapper à l'écrasement, ou à la noyade. Quelques personnes dans l'impossibilité d'atteindre les portes, vinrent se réfugier dans le chœur, plus près de Dieu, plus loin de la tour; cinq ou six d'entre elles s'y évanouirent et y demeurèrent étendues sur le parquet. Une malheureuse aveugle que, dans l'affolement général, sa sœur, son guide ordinaire, avait oubliée, poussée, bousculée, incapable de se diriger elle-même, se trouva, Dieu sait comment! à cheval sur une pyramide de chaises renversées, et là attendant la mort, battant sa coulpe, se frappant la poitrine, elle faisait à haute voix son acte de contrition : «Ma Doué me zo glahared do véan quemen offensed, etc.». «Mon Dieu j'ai une profonde douleur de vous avoir offensé, etc.» Pendant ce temps, ma mère qui tenait les orgues, et la souffleuse, qui toutes deux avaient compris : «An tour» et qui étaient aux premières loges pour être broyées, s'empressaient de gagner l'escalier pour descendre dans l'église et se sauver. Dans l'empressement de la descente, la souffleuse perdit ses sabots qui roulèrent de marche en marche, et ma mère qui la suivait, entendant ce bruit lui criait dans son épouvante : «Mais, allez donc !... plus vite..., plus vite !... N'entendez-vous pas les pierres qui nous arrivent déjà ?» Ces pierres c'étaient les sabots; et de cette méprise on rit plus tard. La sœur d'un médecin de la Roche rentra chez elle ayant laissé dans la bagarre tout le bas de sa robe, mais rapportant en revanche une profusion de livres de messe qu'elle avait inconsciemment pris, elle n'aurait su dire ni où ni à qui. Quand, après force poussées et bourrades, tous les fidèles eurent gagné la rue, ils purent se rendre compte que nulle invasion d'eau ne menaçait l'église et que la tour était encore en place et le rire succéda bientôt à la panique. M. le Curé qui, au moment de l'alerte, avait interrompu son prône, dépouillé sa chasuble et quitté l'église, se retrouva dans la rue, en aube, au milieu de ses paroissiens qu'il ramena à l'église et la messe s'y poursuivit dans le calme. Du côté des hommes il y eut cependant des vides, un bon nombre d'entre eux, répondant à l'appel qui leur avait été fait, étaient allés au secours des naufragés du moulin des Prés. Une barque, transportée en charrette jusqu'au point où la route de Mantallot était coupée par les eaux, y fut mise à flot par eux et dirigée à travers champs et prés jusqu'au moulin. Ce fut là une entreprise aussi hasardeuse qu'audacieuse, car il fallut lutter contre mille obstacles : talus cachés sous l'eau, arbres à demi submergés, mais surtout opposer une résistance acharnée au courant qui était terrible. Les efforts des sauveteurs eurent pour résultat la délivrance des meuniers. L'inondation battit son plein pendant quelques jours encore. Dans une course vertigineuse les eaux se ruaient vers la mer, entraînant et roulant dans leurs flots tourbillonnants tout ce qui se trouvait sur leur passage : planches, madriers, barriques, arbres déracinés, animaux surpris dans les champs et noyés. Tout cela nous le voyions arriver à notre pont et le franchir . c'était un spectacle navrant ! Enfin, les pluies ayant
cessé, les eaux s'écoulèrent insensiblement et le
Jaudy, assagi, regagna son lit. Souhaitons qu'il n'en
sorte jamais plus 1 |
![]()
CHAPITRE XXII LA GUERRE DE 1870. — CELLE DE 1914-1918.— CELLE DE 1939-1945. OCCUPATION ALLEMANDE. — ATTAQUE DU MAQUIS DE COAT-NÉVÉNEZ. — DÉFAITE ALLEMANDE ET LIBÉRATION. -----------------------
Elle devait être plus éprouvée encore pendant la guerre de 1914-1918. Au cours de cette longue et cruelle guerre, où les troupes bretonnes se signalèrent par leur vaillance et méritèrent d'être classées parmi les troupes d'élite, la Bretagne subit une terrible saignée et notre petite ville de la Roche eut à déplorer lu mort de 48 de ses enfants. La population civile vécut dans de cruelles angoisses patriotiques et de mortelles inquiétudes au sujet de ses combattants, mais elle ne connut ici, au cours de cette guerre, ni la souffrance des restrictions, ni la terreur des bombardements qui éprouvèrent tant les habitants du Nord de la France, de l'Est et de la région parisienne. On classait, à l'époque où elle se produisit, la guerre de 1914-1918, comme la plus grande guerre de l'Histoire, celle qui devait, par l'horreur qu'elle avait inspirée, les destructions et les hécatombes qu'elle avait provoquées, clore l'ère des batailles et guérir à jamais les peuples d'en entreprendre d'autres. Hélas I cette guerre vient d'être surpassée en horreurs, en barbarie, en cruauté, en destructions par celle de 1989-1945. Cette fois, ce ne sont pas seulement les peuples de l'Europe qui se battent, le conflit met aux prises les autres parties du monde. Les unes après les autres, les nations de l'Europe sont vaincues par l'Allemagne; la France l'est à son tour, elle est envahie, entièrement occupée. La Bretagne voit surgir les Allemands, et, pour la première fois depuis la destruction de ses fondations, en 1470, la Roche-Derrien voit des ennemis fouler son sol, troubler sa paix. Ils se fixent dans les villes voisines. Bientôt cependant un détachement de ces Allemands maudits vient s'établir à la Roche; nous devons subir leur présence, nous soumettre à leurs ordres, les loger dans nos maisons et nous rongeons notre frein, en refoulant notre colère. Et voici que nos nuits sont troublées par les détonations de la D. C. A. qui se renouvellent même parfois dans la journée. Des combats aériens ont lieu autour de la Roche, deux fois même directement au-dessus de notre ville où tombent quelques balles. Les Boches signalent leur présence dans le pays par de tristes exploits : rafles de jeunes gens, déportations en Allemagne, arrestations de patriotes qu'on torture avant de les envoyer dans des camps de concentration où la barbarie nazie se déchaîna en des raffinements de cruauté inconnus jusqu'ici des peuples civilisés : Buchenwal, Ravensbruck, Dora, Mathausen, Dachau, Neckargerach, etc..., etc..., resteront dans l'Histoire comme autant de flétrissures sur le nom allemand. Ces camps reçoivent des milliers de victimes de martyrs. La Roche-Derrien en compte deux : son très regretté maire, M. François Le Bitoux, coupable d'avoir, en ardent patriote, servi la défense de notre France. Homme juste, droit, charitable et bon, M. Le Bitoux sut, par sa serviabilité et son impartialité, mériter l'estime et l'affection de tous ses administrés, qui savaient trouver toujours chez lui le même accueil affable et bienveillant, : son souvenir restera ici impérissable. La seconde victime des Allemands a été M. Jean L'Hénoret, huissier, déporté pour avoir favorisé le rapatriement de deux sujets anglais, acte de bonté qu'il a payé de sa vie. L'Allemand s'entend à vider de leurs produits les pays qu'il a vaincus. Le pillage de la Bretagne s'organise, les réquisitions commencent : bétail, blé, pommes de terre sont enlevés, consommés sur place ou dirigés sur l'Allemagne. Les denrées de nos épiceries, les tissus de nos magasins, les meubles de nos ateliers suivent la même voie. Et le peu qui nous reste, volailles, œufs, lard, lait el beurre de nos fermes nous est enlevé par des surenchères contre lesquelles nous ne pouvons lutter. Qu'importe le prix fort à l'Allemand ?... N'a-t-il pas derrière lui une machine qui lui fournit à discrétion les faux billets de banque dont il se sert ?... Et chacun doit entreprendre la lutte pour se procurer le nécessaire : on court la campagne, on visite les fermes, on implore pour obtenir la moindre chose; car s'il est des cultivateurs honnêtes et patriotes, il en est malheureusement d'autres, sans conscience, qui ne craignent pas d'affamer leurs concitoyens pour remplir leur bourse. La France, malgré les difficultés du ravitaillement, fait un admirable et prodigieux effort pour nourrir ses prisonniers. En Bretagne, comme partout; des Comités d'assistance s'organisent : la Roche a le sien, adresse mensuellement des colis gratuits à ses chers captifs et peut, à la libération, remettre à chacun d'eux un pécule de 4.760 francs. Et ici, il est de la plus élémentaire justice de rendre hommage au zèle, au dévouement inlassable, à la persévérance des dames de la société rochoise, qui, toutes, abandonnant leurs occupations personnelles et sans souci de leur fatigue, sont venues avec une ponctualité remarquable, jusqu'à la libération, faire les colis de nos prisonniers. A ceux-ci elles ajoutaient encore la confection de colis destinés aux prisonniers d'autres localités du canton qui n'avaient pas de Comité d'assistance : celui de la Roche était cantonal. Dans le premier moment de stupeur occasionné par la défaite, la France avait courbé la tête devant le vainqueur, mais, éprise de liberté, elle ne devait pas longtemps s'y soumettre. Le patriotisme se réveille, l'orgueil national se révolte et la résistance s'organise. Des jeunes gens prennent le maquis, se procurent des armes et entreprennent une lutte sourde contre l'oppresseur : ils le guettent, le harcèlent, lui dressent des embuscades, font sauter des ponts pour entraver sa marche, coupent les fils téléphoniques pour gêner ses communications et se font redouter de l'Allemand, qui croit voir partout des «francs-tireurs». Nos Bretons entrent vite dans ce mouvement. Le moindre de nos bois devient un nid de résistance, un asile de maquisards. Celui de Coatnévénez, près de la Roche-Derrien, en abrite 155 et tout proche de lui, celui de, Coat-Morvan en recèle une trentaine. Le bois de Coatnévénez était attenant à un beau manoir du Moyen Age, transformé en ferme et dont il a pris le nom. Les maquisards semblent y être dans un asile inexpugnable. Hélas ! ils sont repérés par l'ennemi et un certain dimanche, le 9 juillet 1944, on voit, surgir à Pommerit-Jaudy, commune dont dépend ce maquis, des cars bondés d'Allemands en armes, suivis de canons et de mitrailleuses. Au nombre de 5oo, ils viennent attaquer les maquisards. Un certain nombre de ceux-ci étaient absents ce dimanche; les autres surpris au repos et désarmés, s'enfuient ou sont massacrés sans pitié. La fusillade s'entend de la Roche et nous glace d'effroi, elle est terrible ! Mais l'attaque du maquis ne suffit pas aux Allemands; Mme Lestic, la fermière de Coatnévénez (son mari était, prisonnier en Allemagne), a dû parfois subir chez elle la présence de quelques patriotes, il faut qu'ils s'en vengent. Ils viennent au manoir, le pillent, emmènent le bétail et les chevaux, égorgent trois vaches pour festoyer dans la ferme où ils passeront la nuit. Mme Lestic et sa famille avaient heureusement pu fuir échappant ainsi très probablement à la mort qui les attendait. Des patriotes surpris et faits prisonniers par les Allemands dans l'attaque du maquis, sont enfermés par eux dans une chambre au premier étage du manoir. Un domestique de la ferme, René Lanthoine, et des fermiers voisins qui, le combat terminé, s'étaient aventurés dans les allées du Manoir pour voir ce qui s'était passé, sont arrêtés par des sentinelles allemandes. René Lanthoine est abattu à coups de mitrailleuses dans la cour même de la ferme et son cadavre jeté dans une étable où il sera plus tard consumé dans les flammes. Ses compagnons, retenus prisonniers, devaient être relâchés le lendemain, après une atroce nuit d'angoisse pour eux, mais de fête pour les Allemands qui rient, chantent, mangent et boivent pour célébrer leur victoire. Le jour vient, ils vont quitter les lieux, mais pour clôturer la fête, ils décident d'incendier le manoir et ses dépendances qui ne sont bientôt qu'un immense brasier. Les flammes consument le corps de l'infortuné Lanthoine dont on ne retrouvera que le crâne et une partie du dos carbonisés; elles gagnent cette chambre du premier étage, où sont enfermés les maquisards fait prisonniers. L'un d'eux, dont la moitié du corps n'est qu'une vaste brûlure, affolé par la souffrance, s'est précipité dans la cour par une fenêtre ouverte. On devait l'y retrouver le lendemain, les mains liées derrière le dos; il n'avait pas dû se tuer dans sa chute, mais être achevé d'un coup de revolver dans l'oreille. Le cadavre baignait dans une mare de sang. Ce fut, seulement le lundi soir qu'on apprit qu'il y avait des morts dans l'attaque du maquis : un cadavre avait été vu près d'une maison, au bord de la route; on savait qu'il y en avait d'autres dans le bois. Mais comment approcher ?... Des Russes, apostés là par les Allemands, avaient ordre de tirer sur toute personne qui tenterait l'enlèvement des cadavres. Représentante de la Croix-Rouge dans le canton de la Roche-Derrien, je jugeai qu'il était de mon devoir d'aller à la recherche des cadavres et pour cela d'en obtenir l'autorisation des autorités occupantes. Je me rendis à Lannion, vis le sous-préfet qui me proposa de m'accompagner à la Feldkommandantur et là je discutai pendant deux longues heures pour obtenir l'autorisation d'enlever les morts afin de les inhumer et les blessés pour les soigner, s'il s'en trouvait dans le bois. J'obtins péniblement un demi-consentement en ce qui concernait les morts. Pour les blessés ce fut un refus formel. «Ils sont à nous», fut l'invariable réponse que fît le Feldkommandant à chacune de mes instances. Les questions d'humanité et de pitié n'existaient pas pour lui. Ignorant complètement, avant ma venue, ce qui s'était passé à Coatnévénez, le Feldkommandant téléphona successivement à toutes les unités allemandes de la région, pour savoir de laquelle était parti l'ordre d'attaque du maquis. II semble que ce fut de Tréguier, car après avoir reçu la réponse de cette ville, il s'adressa à Saint-Brieuc. Saint-Brieuc à son tour communiqua avec Tréguier (1) et je reçus finalement l'ordre de me ... (1) Saint-Brieuc
avait dû donner à la Kommandantur de Tréguier l'ordre
d'autoriser l'enlèvement des cadavres. ... rendre dans cette ville pour obtenir l'autorisation sollicitée, que seul, le chef qui avait donné l'ordre d'attaque, avait le pouvoir d'octroyer, me dit-on. Entre temps, une religieuse de la Roche qui était venue me proposer de m'accompagner au maquis et qui, pendant que j'étais à Lannion, était allée à Tréguier pour tâcher de m'avoir des brassards de la Croix-Rouge (je n'en avais qu'un nombre insuffisant pour les équipiers qui devaient explorer le maquis), eût l'heureuse idée d'aller à la Kommandantur de cette ville demander l'autorisation d'enlever les cadavres de Coatnévénez. Elle l'obtint, bénéficiant des démarches que je venais de faire à Lannion et des communications téléphoniques échangées entre cette ville, Saint-Brieuc et Tréguier. Résultat, heureux qui permit aux religieuses, à mes équipiers et à d'autres personnes de bonne volonté d'entreprendre immédiatement les recherches dans les taillis de Coatnévénez, ce que mon retour tardif de Lannion et l'obligation d'aller me faire confirmer à Tréguier l'autorisation à demi accordée par le Feldkommandant, n'aurait permis de faire que le lendemain. Neuf cadavres furent trouvés le soir même, les uns horribles à voir, tant l'ennemi s'était acharné à coups de feu ou à coups de crosse sur ces malheureux. Un des corps, squelette plutôt, car les chairs avaient été consumées, fut trouvé les bras et les mains retournés, tordus par la souffrance. Il avait dû être lié sur un siège auquel les Allemands avaient mis le feu; de la paille et du bois restés près de lui l'indiquaient clairement. La nuit fit interrompre les recherches qui reprirent le lendemain et cette fois je pus me rendre, moi aussi, à Coatnévénez. On ne trouva pas de nouveaux cadavres. Mais du beau manoir il ne restait que des murs croulants, calcinés, lézardés; quelques grosses poutres flambaient encore, achevant de se consumer avant de s'effondrer sur le sol. Les cadavres de deux autres jeunes (patriotes faits prisonniers au maquis de Coatnévénez, furent trouvés plus tard, l'un dans une fosse commune, au camp de Servel, l'autre dans la rivière Le Jaudy, en face du maquis. Les Allemands qui l'avaient emmené à Plouaret, où existait une chambre de torture, le ramenèrent là en auto pour le fusiller et jeter son corps dans la rivière. Trois semaines après les
tragiques événements de Coatnévénez, la ville de la
Roche-Derrien était en liesse (2 août 1944) on y
fêtait la libération de Rennes dont la nouvelle venait
de se répandre. Un cortège se forma, se rendit au monument des morts et parcourut les rues de la ville, drapeau en tête, au chant de la Marseillaise. Hélas ! cette soirée si joyeusement commencée, devait, pour deux de nos concitoyens, s'achever d'une façon tragique. MM. François Loyer et Pierre Kermarec, rentrant chez eux, la manifestation terminée, se trouvèrent soudain en présence d'une automobile en panne qui était celle de la gestapo. Un «halte» retentit, aussitôt suivi de deux détonations. La patrouille avait tiré dans les jambes des deux amis : M. Loyer avait reçu une balle au talon, M. Kermarec une autre au-dessus de la cheville. Les deux blessés furent transportés en clinique où M. Kermarec dut subir l'amputation de la jambe et M. Loyer être sérieusement soigné, dans deux séjours successifs. Deux jours après cet événement, le 4 août 1944, une colonne d'allemands arrivait à la Roche, stationnait un moment sur la place et prenait ensuite la direction de Pontrieux. A la sortie de notre ville, au niveau du cimetière, se trouvaient au moment où ils allaient passer, deux cousins, deux maquisards de Coatnévénez. Ils étaient armés, mais que pouvaient deux hommes contre cette colonne ?... L'un des cousins se défile par un chemin creux; l'autre, Denis Bouffant, entre dans un champ, mais il a été aperçu par l'ennemi. Un Allemand le suit, pénètre dans le champ, le blesse à la jambe d'un coup de revolver et le lance par-dessus le talus sur la route, où un autre allemand l'achève d'une balle dans l'oreille. Ils dissimulent ensuite le cadavre sous des ronces. Pendant ce temps les autres allemands de la colonne, redoutant sans doute une attaque des maquisards, se déploient en tirailleurs sur la route; quelques-uns même, escaladent la grille d'une propriété voisine et y pénètrent pour se mettre en embuscade. Il est heureux pour la Roche que cet incident soit survenu au moment où les ennemis, conscients de leur défaite, ne cherchaient qu'à gagner Pontrieux et sa voie ferrée pour quitter notre pays et regagner le leur. En d'autres temps la rencontre de Denis Bouffant eût pu leur être un prétexte à renouveler leur effroyable exploit d'Oradour-sur-Glane, mais Pontrieux les attirait !... Il leur fut impossible cependant d'atteindre cette ville : les routes étaient coupées !... Et, le lendemain nous les vîmes, mornes, semblables à des bêtes traquées, revenir sur leur pas, repasser à la Roche, l'arme à la main, prêts à faire feu à la moindre alerte. J'étais alors à la Mairie, achevant, avec Mme Gélard, femme du Maire de l'époque, de dresser le lit mortuaire de Denis Bouffant, dont le cadavre, découvert par un enfant, le soir même du meurtre, y avait, été déposé. Oh ! s'ils avaient su que leur victime de la veille nous l'avions transportée là, quel sort eût pu être le nôtre ! Des obsèques solennelles furent faites par la Roche à Denis Bouffant. Elles furent suivies par une foule émue et recueillie mais donnèrent lieu cependant à un incident. Le convoi franchissait la porte du cimetière quand on vit arriver à toute allure, une automobile remplie de gens en armes et casqués. On crut à une intervention des allemands pour troubler la cérémonie et un moment de panique s'ensuivit. Mais on se rendit vite compte que ces casques ne coiffaient pas des têtes de boches : ceux qui survenaient ainsi étaient des maquisards, amis du pauvre mort, qui venaient saluer d'une dernière salve sa dépouille mortelle. A la tristesse de ces événements succédèrent bientôt une profonde joie et une immense espérance. Le débarquement des Alliés en France avait eu lieu; la Normandie était dégagée, nous avions fêté la délivrance de Rennes et savions les américains à Saint-Brieuc et voici que le 12 août deux de leurs camions arrivent à la Roche et y stationnent; l'un devant la mairie, l'autre devant le presbytère. Quelle surprise, quelle émotion !... En un moment toute la population rochoise les entoura : ce fut de l'enthousiasme, du délire ! Un inexprimable bonheur rayonnait sur tous les visages; chacun serrait les mains des Sammies; on leur demandait leur signature, qu'on s'arrachait en souvenir de cette visite, prometteuse de prochaine délivrance; des pères, des mères tendaient à bout de bras leurs enfants pour les embrasser et dans le baiser donné par ces petits, c'était bien à l'Amérique, alliée et amie, le reconnaissant baiser de la France. Deux jours plus tard, le 14 août, nouvelle visite des Américains. Cette fois, il ne s'agit pas seulement de deux camions apportant une espérance de victoire, c'est la victoire elle-même qui vient à nous, sous forme d'un impressionnant, d'un formidable matériel de guerre dont la puissance et la force semblent irrésistibles. Pendant près de trois heures, chars d'assaut, canons de tous calibres, mitrailleuses, armes de toutes sortes, défilent dans nos rues où le convoi stationne un moment, ce qui permet aux Rochois de témoigner sympathie et reconnaissance aux hommes qui le conduisent : on leur offre du vin, des œufs, des fruits, tout ce que l'on possède : ne sont-ils pas nos défenseurs et ne vont-ils pas exposer leur vie pour nous ? Oui, nous en avons maintenant la certitude, ce convoi c'est bien cette fois la victoire en marche. La libération de Tréguier, opérée le jour même par un détachement de ces troupes américaines de passage à la Roche en est, dans notre région, l'heureux prélude. Et désormais nous nous représentons, les boches, orgueilleux vainqueurs d'hier, misérables vaincus de demain, traqués, chassés de partout, poursuivis l'épée dans les reins jusqu'à la frontière de l'Est, pour être bientôt rejetés chez eux. Et c'est sur cette radieuse vision de victoire que je clos ce simple récit, le passage des américains à la Roche ayant été le dernier événement marquant qu'ait vu notre vieille et si chère cité : cité petite par sa superficie et par le chiffre de sa population, mais si grande, si noble par son origine, son passé, son histoire et surtout par les souvenirs qu'y ont laissés Jeanne de Penthièvre, duchesse de Bretagne, le duc Charles de Blois, son époux et l'incomparable héros breton que fut Bertrand Duguesclin, Seigneur de la Roche, connétable de France. |
![]()
CHAPITRE XXIII HISTOIRE DE LA ROCHE (Suite) -----------------
Fin juin 1949, la toiture du lavoir communal, qui avait abrité ce jour-là 29 blanchisseuses, s'est effondrée brusquement au moment où la dernière ouvrière venait de le quitter. Si cet accident s'était produit un peu plus tôt, il eût fait infailliblement des victimes et c'eût été une véritable catastrophe à déplorer. «Mais», me disait un peu plus tard une des rescapées, «nous avons là-haut une Mère qui veille sur nous». Cette Mère, en qui les Rochois ont mis de tout temps leur confiance, est Notre-Dame de Pitié dont l'antique sanctuaire, édifié sur une hauteur, surplombe de profondes carrières et le Jaudy qui coule sur leurs bords. Et nos blanchisseuses, dans leur ardente reconnaissance, ont fait dire une messe dans sa chapelle, en l'honneur de leur divine protectrice. Il est un fait remarquable, c'est que du chemin dangereux qui mène à son sanctuaire et qu'aucune barrière, qu'aucun mur sérieux ne protègent contre les carrières, des enfants y ont fait de terribles chutes où ils auraient dû se tuer mille fois et tous s'en sont tirés indemnes. Une voiture, attelée d'un cheval y a été précipitée avec son conducteur et cet homme en est sorti, lui aussi, sans une égratignure. Une femme, devenue folle, y a précipité sa fille et l'enfant en est sortie saine et sauve. Ce sont là des faits qui tiennent du miracle. Et de là la prédilection toute spéciale des Rochois pour ce sanctuaire, leur amour profond pour Notre-Dame de Pitié, celle qu'ils appellent avec une respectueuse et confiante tendresse : «Mamm goz ar Roc'hiz,» Ils eurent recours à elle pendant la dernière guerre (1939-1940) et firent vœu de lui offrir une belle bannière si notre ville était épargnée : ils ont été exaucés. Des combats ont eu lieu aux alentours : à Tréguier dont quatre kilomètres nous séparent, plus près de nous encore à Coatnévénez, en Pommerit-Jaudy, situé à 2 kilomètres; à Langoat, distant d'un kilomètre, où une bagarre a éclaté entre allemands et maquisards... et à la Roche, rien. La guerre achevée, les Rochois ont accompli leur vœu. A. cette occasion, l'antique statue de Notre-Dame de Pitié qui n'avait jamais quitté la chapelle, en a été sortie pour être portée processionnellement en triomphe dans les rues de notre ville et recevoir l'hommage reconnaissant, de la population qu'elle avait si manifestement protégée. . |
![]()
i APPENDICE ----------------
La population rochoise, au dire de tous ceux qui la connaissent, est une population à part, une population spéciale. Peut-être doit-elle cela à un atavisme hérité des guerriers ses ancêtres, qui durent soutenir des siècles de luttes pour se défendre, vivre perpétuellement sur le qui vive, user de ruses, de stratagèmes pour échapper à l'ennemi ou déjouer ses embûches : A ce jeu, les facultés se développent, l'esprit s'affine. Le Rochois d'aujourd'hui, bénéficiaire des qualités acquises par ses devanciers, est donc brave, adroit, ingénieux et débrouillard. Il a l'intelligence vive, l'imagination féconde, la répartie facile; vous ne le prendrez jamais de court, il a réplique à tout. Je n'en citerai qu'un exemple. Nous avions un Curé qui était M. l'abbé Lecocq. Il faisait procéder à la réparation des toitures de notre église et des couvreurs s'activaient à cette besogne, quand vint à passer une charrette remplie de paysans. L'un de ceux-ci, dans l'esprit de taquinerie qui s'exerce avec tant de facilité sur le chauvinisme rochois, s'adressant aux ouvriers leur cria : «Ar Roc'hiz a yo ken paour ken no deuz ked galla prenan eur c'hog da lakaet war dour oc'h iliz» (Les Rochois sont si pauvres qu'ils n'ont pas pu acheter un coq pour le mettre sur le clocher de leur église). Un des couvreurs se retourne et, du tac au tac, répond : «Oh ! bezan a oa unan, met bet neus urz digant e eskob da diskenn ebarz an iliz hag enon breman c'ha, a deu, a gan hag a brezeg:» (Oh ! il y en avait bien un, mais il a reçu ordre de son évêque de descendre dans l'église et là, maintenant, il va, vient, chante et prêche.) C'était une allusion au nom de notre Curé. Ce même M. Lecocq était réputé pour son éloquence, un Rochois le surnomma Bossuet. Mais ce mot était à double entente, car notre Curé avait le dos rond : Bossuet exprimait, l'éloquence, Bossu est soulignait la légère défectuosité physique. Et ce nom de Bossuet me remet en mémoire les surnoms qui foisonnaient à la Roche au temps de mon enfance, car, avec sa mentalité spéciale et l'esprit qui le caractérise, le Rochois est naturellement porté à la satire : aucun travers, aucun ridicule, aucune imperfection physique ou morale n'échappe à son observation et aussitôt d'un mot, d'un trait, qui fait image, il a dépeint son personnage ! C'est ainsi que d'un homme très grand et mince il a fait «ar skeul» (l'échelle). Un autre de haute taille aussi, mais plus carré, devient : «Kased orloj» (La caisse à horloge). Un troisième à la démarche lourde et disgracieuse est baptisé : «Job ar Park» (L'homme des champs). Un quatrième aux manières douces et distinguées est appelé : «An dimezel» (La demoiselle). Une famille dont tous les membres sont d'une maigreur squelettique devient : «An druoni» (La graisse). Une femme était désignée sous le nom de «ar Gelienen» (La mouche) et sa fille, petite, menue, vive, sémillante, devenait : «L'oiseau-mouche». Deux femmes vivant ensemble et ne se quittant jamais étaient nommées : «Àr goukou hag hé evn» (Le coucou et son oiseau), allusion au fait que le coucou dans son vol est, souvent suivi d'un autre oiseau. Une-femme bavarde : «An teod» (La langue). Un homme au menton proéminent : «Ar c'hronj» (Le menton). Une personne qui portait deux paires de lunettes superposées : «c'houec'h lagad» (Six yeux). Nous avions aussi : «an tenn» (coups de fusil) parce que celui-ci, lors de l'inondation qui désola la Roche, se prétendit fort d'enrayer le fléau (de même qu'on éteint parfois un feu de cheminée), en y tirant un coup de fusil. Cette prétention fit la joie des Rochois, dont il n'était pas originaire, et lui valut son surnom. Une femme riche et voûtée portait le nom de «An tort aour» (La bosse d'or). A cette liste déjà longue, il convient d'ajouter : «Ar squoa vaout, Jeannik bibi, Ar penton, Rossignolik abalamonrik, Lagad bihan, Kalonek mé, Dorek fallo, Jobik ar Bouek, Mallargé, Ar zorcer, Tad ar pain, Kilik ma nan, etc., etc. Il en existait une foule d'autres. Parmi les surnoms donnés ici, il en est de si crus de si malodorants que ma plume qui respecte les lecteurs et se respecte elle-même, se refusait à les écrire ! On m'a fait observer qu'ils sont si particulièrement marqués au coin de la satire rochoise, que je ne devais pas les passer sous silence. Je les sors donc de l'ombre où je voulais les maintenir, mais non sans m'en excuser près de ceux qui les liront. Les voici : «Ar louv» un homme ainsi désigné en raison des flatuosités dont il était coutumier. «Ar Gac'herez». Je laisse au lecteur le soin de traduire. «Ar Gac'herez canettigner», celle-ci ainsi appelée parce que sèche et dure. La satire rochoise présumait que tout chez elle, même les déjections, devait participer de la sécheresse et de la dureté des billes (ou canettes) dont les enfants se servent dans leurs jeux. Cette même femme était gratifiée d'un second surnom : on l'appelait aussi; «Ar gevniden» parce qu'on la disait avare et qu'on se la représentait comme l'araignée qui veille dans sa toile et replie ses longues pattes pour attirer sa proie à elle. En revanche, certains Rochois portaient des noms glorieux : nous avions le «Tad Éternel» (le Père Éternel), «Sant Per» (Saint Pierre), «Sant Anton» (Saint Antoine) ainsi nommés pour leur ressemblance avec des images représentant Dieu et ces saints. Nous avons même eu une Jeanne d'Arc, une femme dont les vêtements, accidentellement inondés de pétrole, prirent feu et qui, vraie torche vivante, eut tout un côté du corps atrocement brûlé. Plus heureuse que la sainte Lorraine, elle ne mourut pas de ses brûlures; après un an d'horribles souffrances elle s'en remit et vécut encore de longues années. Les surnoms, à la Roche, s'étendaient aux ascendants et aux descendants de ceux qui les portaient. On disait couramment par exemple : «Mamm Sant Per»; Merch ou Mab Mallargé», «Merch ar Zorcer», «Merch ar Pentonn», etc., etc. Les noms de famille finissaient par s'oublier complètement et le sobriquet devenant roi, était seul connu. Il convient de mentionner aussi que les ouvriers rochois ont créé, pour leur usage personnel, un langage, compris d'eux seuls, qui leur permet de converser entre eux en dehors de toute immixtion étrangère. Le Rochois n'est pas seulement homme d'esprit : il est homme de goût et il a du cœur. Son goût il l'a prouvé maintes fois à l'occasion de fêtes, notamment à l'occasion d'un Congrès Eucharistique qui fut, au dire même de Mgr Serrand, le plus beau du diocèse. Mère splendeur à la Roche pour le passage de Notre-Dame de Boulogne. Quant à son cœur, le Rochois le révèle en toute circonstance : qu'un accident survienne, qu'un incendie s'allume, toute la population accourt et se dépense sans compter pour porter secours. Qu'un pauvre ait besoin de quelque chose, chacun, apitoyé, s'ingéniera à le lui procurer; qu'une personne soit malade, c'est à qui lui offrira ses services et cherchera à la soulager, car il existe entre les Rochois une solidarité vraiment touchante. Je me suis beaucoup étendue
sur les qualités de mes chers concitoyens, mais comme la
perfection n'est pas de ce monde, ce beau côté de la
médaille a aussi son revers. Que les Rochois me
pardonnent d'aborder ce sujet délicat ! Je le fais dans
ma sympathie pour eux, afin de laver notre bonne
population de l'injuste accusation qu'on a fait peser sur
elle; la voici : Loin de moi la pensée d'excuser, encore moins d'approuver ce qui dans les actes de maraude était certainement répréhensible; mais si l'on considère la grande misère dont souffrait encore, il y a un siècle, la population ouvrière et chiffonnière (celle-ci éteinte aujourd'hui) de la Roche, on ne peut, en toute justice, que lui accorder le bénéfice des circonstances atténuantes. A l'époque qui nous occupe on ne connaissait ni les allocations familiales ni les assurances sociales. Un ouvrier spécialisé gagnait 2 fr. 5o par jour. Le chiffonnier qui s'épuisait dans de longues courses journalières à travers la campagne, ne gagnait guère davantage. Comment avec un salaire si minime payer un loyer, nourrir une femme et des enfants, pourvoir à leur habillement ? Dans ces conditions la tentation était grande de s'approprier un chou, quelques pommes de terre ou quelques carottes lorsqu'on passait devant un champ qui en regorgeait ! Quel homme de cœur eût pu faire un crime à ce père que la misère poussait à la maraude, d'apporter cet appoint au maigre menu des petites bouches qui attendaient de lui leur provende ? Dieu qui est toute justice et toute bonté a dû être très indulgent à ces fautes de maraude : Lui qui donne la pâture aux petits des oiseaux, la refuserait-il aux enfants des hommes ? Avec l'augmentation des salaires et les allocations familiales la maraude a disparu et l'aisance est entrée dans toutes les maisons ouvrières de la Roche. Les taudis d'autrefois, où l'ordre était impossible à établir parce que père, mère et enfants y vivaient entassés dans une pièce unique, ont fait place à des logis sains, bien entretenus, où règnent l'ordre, la propreté et un sens de l'agencement qui fait honneur au bon goût de nos ménagères rochoises. En ce qui concerne la maraude, il était nécessaire de remettre les choses au point et de ramener les faits à leurs justes proportions : voilà qui est fait et qui dissipera, je l'espère, le discrédit injuste, parce que trop sévère, qu'on avait fait peser sur les Rochois. Je viens de m'insurger contre cette ridicule légende qui tendait à présenter tous les Rochois comme des voleurs; mais s'ensuit-il que nous soyons sans défauts ?... Non, hélas ! nous avons tous, moi comme vous, nos travers, nos imperfections : nous manquons de persévérance, d'esprit de suite. Le Rochois est enthousiaste, il s'emballe facilement et adopte d'emblée toutes les nouveautés; mais l'accoutumance vient bientôt et l'indifférence lui succède, quand il faudrait, au contraire, conserver ce qui existe et relever ce qui tombe. De cette versabilité, voici des exemples : Nous avons eu successivement ici deux sociétés de musique qui eurent d'abord un plein succès et nous étions fiers de voir nos jeunes cliquarts défiler dans nos rues en exécutant les jolis morceaux de leur répertoire. Qu'en est-il resté ?... Le souvenir !... C'était là feu de paille qui brille et flambe un instant pour s'éteindre aussitôt. Le Mardi de Pâques était à la Roche la fête du Bouquet qui se célébrait en grande pompe et attirait ici une foule nombreuse : on l'a laissé tomber. Nous avions le vendredi un marché bien achalandé : qu'avons-nous fait pour le rétablir ?... La Motte du château, que nous appelons le Calvaire, lieu historique que nous devrions respecter et conserver avec soin comme une précieuse relique de notre passé est devenu le terrain de jeu des enfants qui y dégradent les murs et y saccagent tout. Il en est de même du quai qui était intact et net, mais dont avec une insouciance coupable on avait fait un dépotoir qui masque aujourd'hui une partie de son mur. Il faudrait plus de soin d'une part, plus de persévérance d'autre part pour que notre Roche, chef-lieu d'un canton de douze communes, ne tombe pas au rang de la plus petite bourgade. Dans l'ordre des sentiments, je constate la même carence. Au temps de ma jeunesse, et même longtemps après, notre église était pleine à déborder, d'hommes dans la chapelle du château, de femmes dans la nef, si bien qu'on avait dû reléguer les enfants le long des murs des bas-côtés. Aujourd'hui, et bien que ces enfants aient repris place dans la nef, que de vides !... Et je me demande : Dieu aurait-Il cessé d'exister ?... Non, car II nous donne toujours la lumière et la chaleur de son soleil qui font germer nos semences et mûrir nos moissons. Serait-ce donc que les Rochois se seraient éloignés de Lui pour mettre, selon une triste conception moderne, toute leur foi en la science ?... La science a bien amélioré, incontestablement, les conditions de la vie humaine; on ne peut que le reconnaître et lui en savoir gré. Mais cette science a ses limites. Est-il un savant, si grand que soit son génie, qui ait pu faire le soleil, la lune et les étoiles et les accrocher au firmament ?... En est-il un qui puisse faire seulement le moindre grain de blé ?... Le grain de blé, un savant l'imitera peut-être, encore devra-t-il pour le produire utiliser des matériaux, des substances qui existaient avant lui et qui étaient des dons du Créateur à l'homme. Que ce savant mette son grain de blé en terre et lui donne tous les soins que réclame la culture, jamais, quoi qu'il fasse, ce grain de blé ne donnera naissance à un épi... Pourquoi ?... Parce que, malgré toute sa science et son génie, ce savant n'aura pu y mettre le germe de vie que Dieu seul a pu déposer dans chacune des œuvres sorties de ses mains. Dieu crée la vie : la science cherche les moyens de semer la mort : pour les combats sur terre elle a multiplié les armes; elle a produit les explosifs, le lance-flamme, les gaz asphyxiants. - Dans les mers elle a mis les sous-marins et les mines; dans les airs les avions de combat et les avions bombardiers. Elle a en outre, réalisé la bombe atomique, terreur de tous les peuples du monde, qui vivent en tremblant sous sa menace. Et cela ne lui suffit pas !... Elle a mis à l'étude la bombe à hydrogène, qui serait infiniment plus meurtrière encore. Devant cette haine qui divise les hommes et provoque les armements, je comprends mieux la beauté de la doctrine toute de douceur et de charité du Christ et je pense au message qui nous fut apporté à Sa naissance. «Gloire à Dieu dans le ciel et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.» Oui, gloire à Dieu, le grand Maître de qui nous tenons tout : gloire à Lui, dans le ciel, et gloire à Lui sur la terre en nous associant au culte qu'il a Lui-même institué. Et les hommes trouveront alors la Paix dans l'exercice de la charité fraternelle que leur demande le Christ. Ne croyez-vous pas comme moi, mes chers concitoyens, qu'il y a pour chacun de nous dans la soumission à ce message de Noël une garantie de bonheur ?... Un vrai bonheur que vous souhaite de tout cœur, très ardemment, la vieille Rochoise que je suis, et qui n'a eu qu'un seul désir : venir terminer ses jours au milieu de vous et reposer ensuite à l'ombre de notre cher clocher. |
![]()
--------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Les Presses Bretonnes. Imp. Saint-Brieuc. N° d'Impression : fait. Dépôt légal : 3° trimestre 1952. |
![]()
 |
Evit komz diouzh al levr-se / pour discuter de cet ouvrage : |
 |